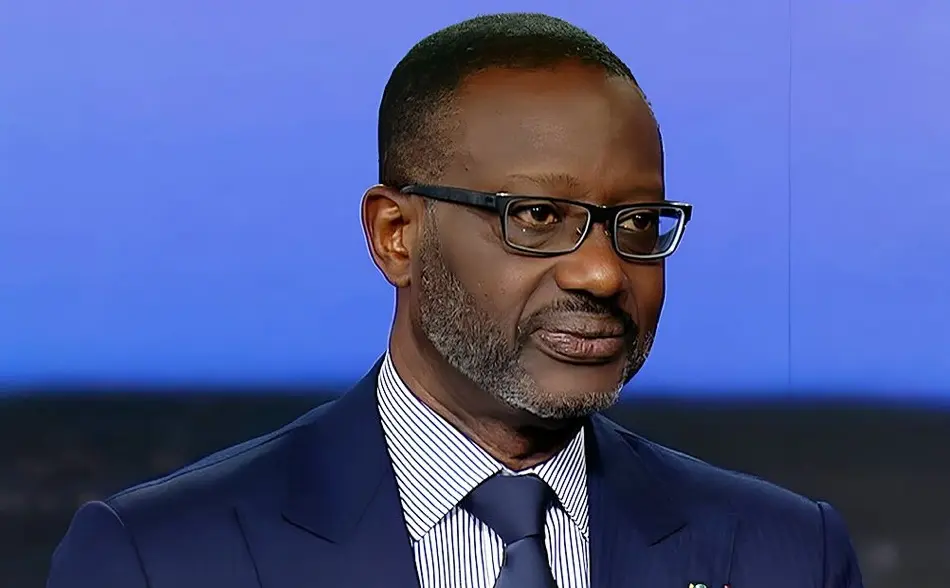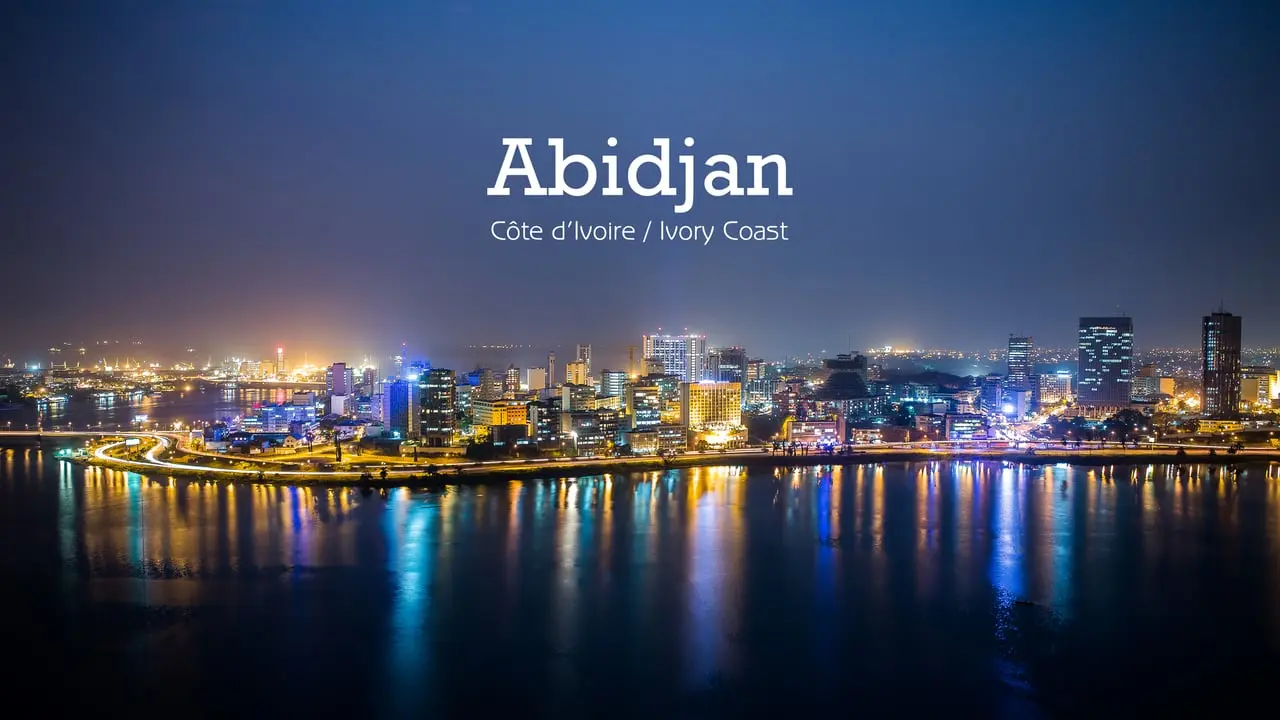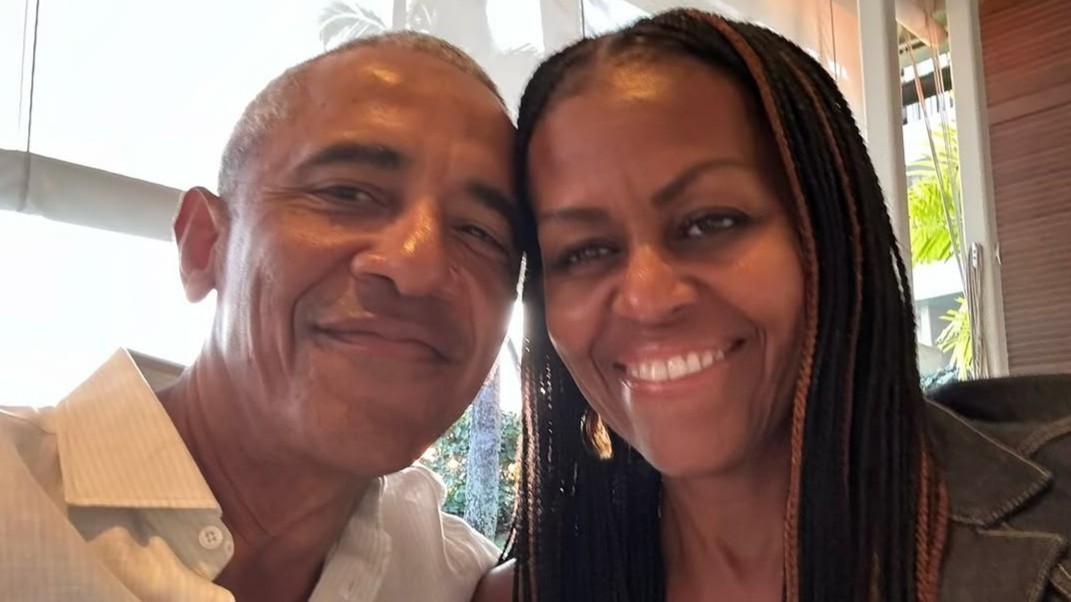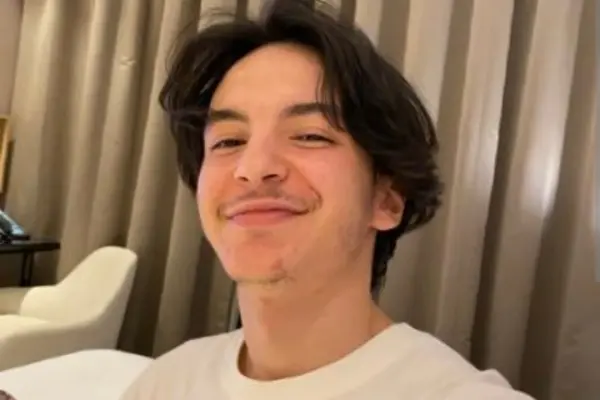Un énigmatique empire oublié refait surface

A son apogée, l'antique cité d’Hattusa, capitale de la civilisation hittite, devait être impressionnante. Construite sur un versant dans le centre de l’actuelle Turquie (Türkiye), elle abritait 7 000 habitants, de vastes complexes de temples et un imposant rempart de pierre visible à des kilomètres à la ronde.
De nos jours, il ne subsiste plus guère que des fondations en pierre à moitié recouvertes d’herbes sèches. Certaines des portes de la ville sont encore en partie debout, sous la bonne garde de statues de lions, de sphinx et d’un dieu brandissant une hache. Mais une large part des vestiges a disparu. Les murs de briques en terre crue se sont effondrés au fil des siècles ; les inondations et la fonte des neiges ont érodé les pentes, emportant en contrebas les édifices et les tablettes d’argile qu’ils contenaient. Encore plus ténus sont les indices qui pourraient expliquer ce qu’il est advenu du puissant peuple hittite – dont les chercheurs commencent à mieux comprendre l’empire perdu.
Sa disparition, vers 1180 av. J.C., constitue une énigme qui n’a que peu d’équivalents dans l’histoire. Durant au moins quatre cent cinquante ans, les Hittites contrôlèrent une grande partie de l’actuelle Turquie et au-delà – des régions proches de la mer Noire aux fleuves de la Mésopotamie et aux eaux de la Méditerranée. Ils ont édifié des villes sophistiquées, des temples et un palais raffiné dans la campagne sauvage de l’ Anatolie. Ils ont aussi laissé de vastes archives composées de tablettes cunéiformes rédigées dans de nombreuses langues anciennes et décrivant des rituels sacrés. Leurs souverains devaient leur puissance aux routes commerciales s’étendant bien au-delà de leur territoire. En une occasion, leurs armées pénétrèrent même profondément en Mésopotamie. Et leur affrontement avec le pharaon Ramsès II lors de la bataille de Qadesh se conclut par le premier traité de paix de l’histoire.
« Ils étaient capables d’affronter les Égyptiens, et les Babyloniens comme les Assyriens devaient les traiter sur un pied d’égalité », explique Andreas Schachner, de l’Institut archéologique allemand qui mène des fouilles à Hattusa depuis un peu plus d’un siècle. Cependant, « les Égyptiens comme les Assyriens faisaient partie intégrante de la mémoire historique. Les Hittites, eux, avaient complètement disparu ».
Les spécialistes ne prirent conscience de leur existence que trois mille ans plus tard, lorsque certains bas reliefs des temples de l’Égypte antique, ainsi que des correspondances diplomatiques découvertes sur des tablettes d’argile suscitèrent une compétition internationale pour localiser l’emplacement de leur capitale. Des fouilles menées sur son site présumé au début du vingtième siècle mirent au jour quantité de tablettes cunéiformes en argile qui confirmèrent les soupçons faisant d’ Hattusa la capitale perdue des Hittites.
Grâce aux vestiges exhumés sur place – un centre de commerce, de culture et de pouvoir militaire autrefois très dynamique –, les chercheurs ont pu ressusciter la vie dans l’empire, des querelles royales aux cérémonies religieuses, en passant par la punition appropriée pour avoir tué un chien. Cependant, les causes de l’effondrement de l’empire restent toujours un mystère.
De juin à octobre, sept jours sur sept, Andreas Schachner sillonne Hattusa et supervise une équipe d’archéologues turcs et allemands, ainsi que des dizaines de travailleurs de la région. En tant que directeur des fouilles de l’Institut archéologique allemand, il s’efforce de donner un sens aux ruines disparates du site depuis 2006. « Rien n’est à sa place d’origine, soupire-t-il. Tant de choses ont été détruites. »
Je le retrouve dans le complexe du Grand Temple de la ville, qui regroupe espaces rituels, cours, entrepôts et chambres secrètes non loin des portes nord de la capitale. Je le suis parmi des blocs de pierre nous arrivant à la taille, jusqu’à ce qui formait jadis le centre de l’univers hittite : le Grand Temple dédié au dieu de l’Orage, Tarhunna, et à sa partenaire, la déesse-soleil Arinna. Les fondations entourant le site conservent les contours de quatre-vingts resserres autrefois emplies de vin, d’eau et de céréales. Les chercheurs ont découvert des inventaires faisant allusion aux richesses qui y étaient entreposées. « Quand le roi revenait de campagne, le butin était destiné au dieu de l’Orage, précise l’archéologue, et il devait le stocker ici. »
Andreas Schachner espère notamment comprendre pourquoi les Hittites ont choisi d’ériger leur capitale ici. Il existe bien des sites pires que l’Anatolie centrale pour fonder un empire, mais ils sont peu nombreux. À mi chemin entre la mer Noire et les déserts de Syrie, Hattusa est tiraillée entre les extrêmes. Les sources d’eau douce abondent dans les montagnes rocailleuses et quasi incultivables des environs. En revanche, les quelques plaines de la région sont extrêmement arides la majeure partie de l’année – sauf durant les inondations saisonnières.
La lecture attentive des textes hittites, combinée aux données environnementales, montre que des sécheresses ont frappé la zone toutes les décennies environ, poussant régulièrement les populations au bord de la famine et au-delà. « Compte tenu du climat et de l’environnement, il est incroyable qu’ils aient construit tout cela ici », résume – à la fois admiratif et perplexe – l’archéologue Bülent Genç, qui enseigne à l’université Artuklu de Mardin, en Turquie, et travaille avec Andreas Schachner à Hattusa.
La clé de l’énigme réside dans une combinaison de résilience, d’adaptation et de planification. Durant les siècles où ils ont régné, les seigneurs d’Hattusa sont parvenus à soutirer du territoire juste un peu plus de ressources que n’importe qui avant ou après eux. S’appuyant sur ce que l’on connaît de leurs pratiques pastorales – ainsi que sur les énormes quantités d’ossements animaux trouvés sur place –, Andreas Schachner pense que les versants alentour abritaient des dizaines de milliers de moutons et de chèvres, fournissant un mode de subsistance alternatif aux fermes dépendant de l’irrigation de l’Égypte et de la Mésopotamie.
Pour approvisionner en eau les activités industrieuses et l’agriculture, les Hittites creusaient des réservoirs dans le sol argileux d’ Hattusa. Alimentés par les eaux souterraines, certains étaient plus grands qu’une piscine olympique et pouvaient atteindre 8 m de profondeur. Par ailleurs, d’immenses silos souterrains renfermaient assez de grain pour nourrir les bêtes en période de sécheresse.
Ces infrastructures étaient entourées de solides murailles courant sur 7 km et conçues pour s’adapter au terrain accidenté avec ses pentes abruptes sillonnées de profonds ravins. De 2003 à 2006, un segment de 65 m de cette enceinte fut reconstruit avec les seuls matériaux dont les Hittites disposaient à leur époque, dont du bois, de la pierre et 2 700 tonnes de briques en terre crue. Les chercheurs en déduisirent que la construction d’un mur de seulement 1 km aurait mobilisé un millier d’hommes pendant un an – une véritable prouesse logistique.
C’est sur le point culminant d’Hattusa que subsiste l’aménagement le plus impressionnant de la ville : Yerkapi, un rempart de plus de 40 m de hauteur, s’étirant sur 250 m. Dans ce grand glacis défensif en pierre blanche s’ouvre une porte étroite décorée de statues de sphinx. Une partie du mur de protection de la ville court jusqu’au sommet de ce talus, ce qui ajoute à son imposant impact visuel.
Par temps clair, cette structure monumentale est visible à 20 km de distance, ses pierres d’un blanc éclatant se détachant sur le vert et le gris des montagnes. « J’ai vu beaucoup de sites, me dit Andreas Schachner, mais aucun qui soit, vu de loin, aussi impressionnant que celui-ci. C’est ainsi que [les Hittites] exerçaient leur contrôle sur le paysage. »
Quelle est votre réaction ?
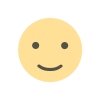 J'aime
0
J'aime
0
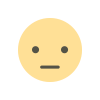 Solidaire
0
Solidaire
0
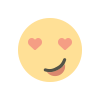 J'adore
0
J'adore
0
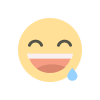 Drôle
0
Drôle
0
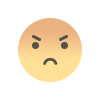 En colère
0
En colère
0
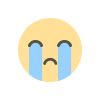 Triste
0
Triste
0
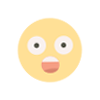 Wow
0
Wow
0