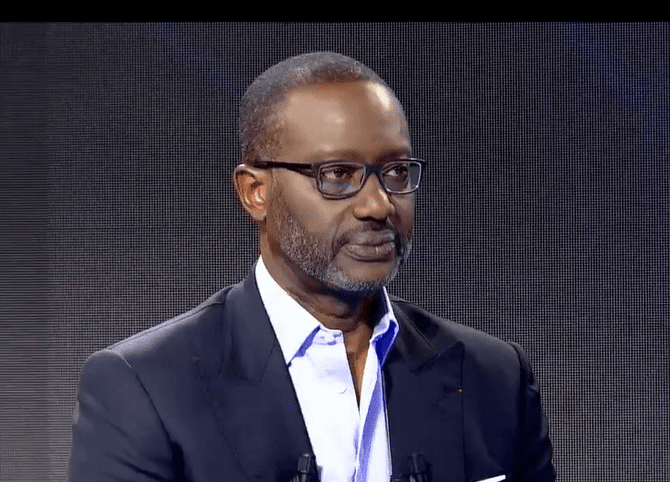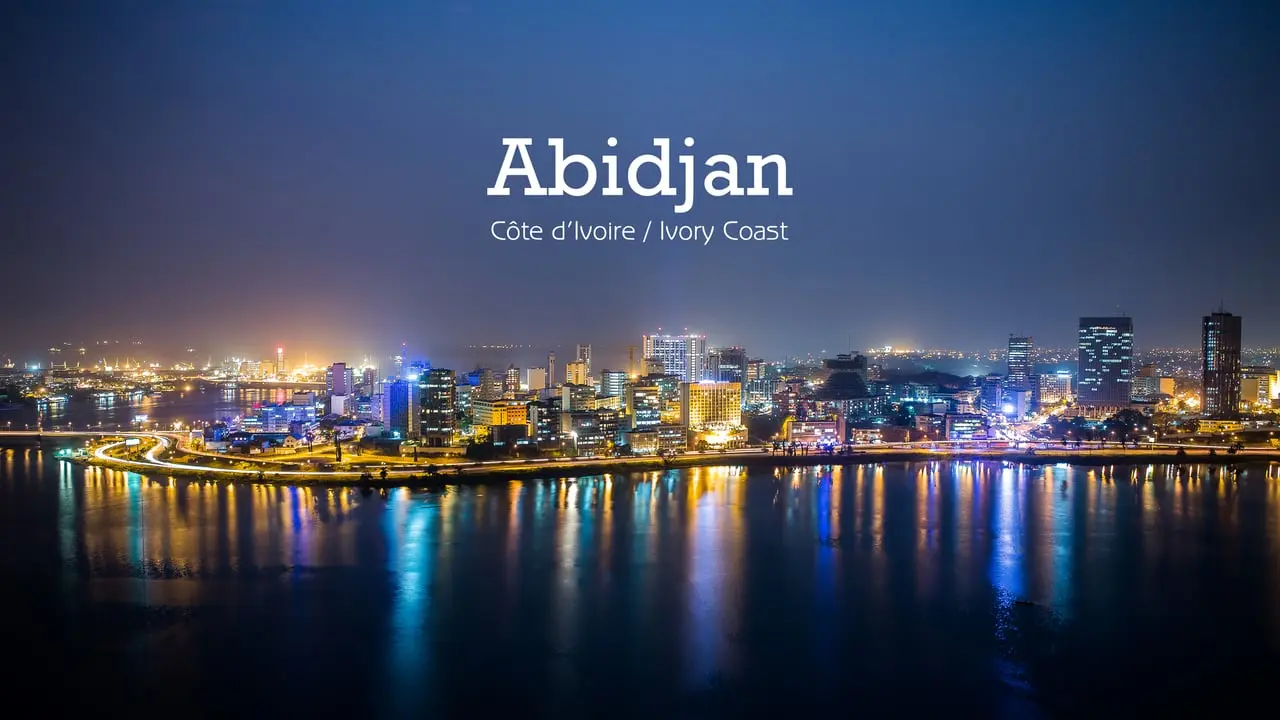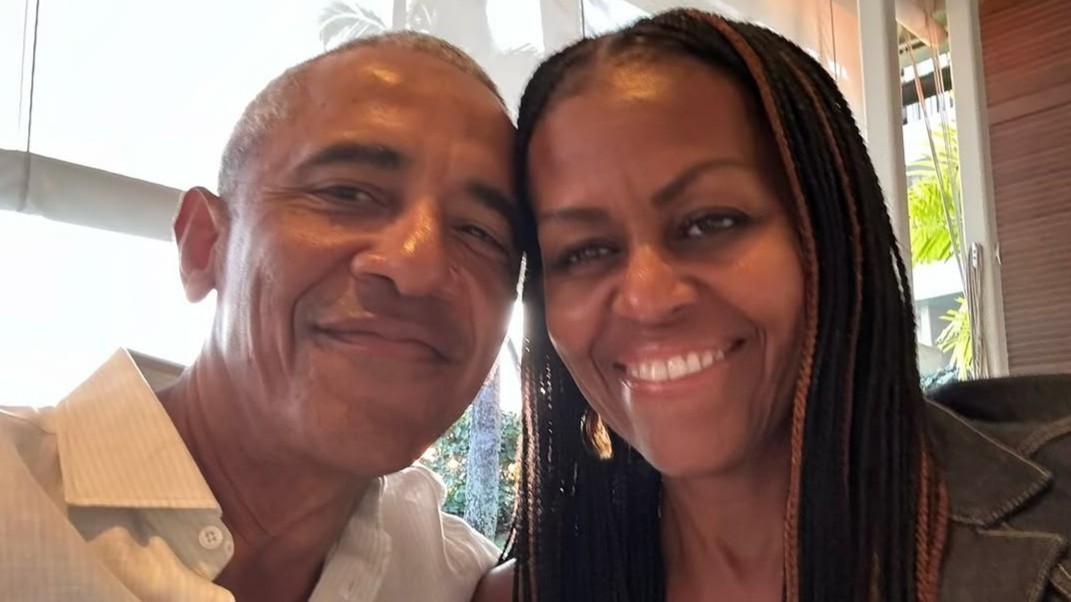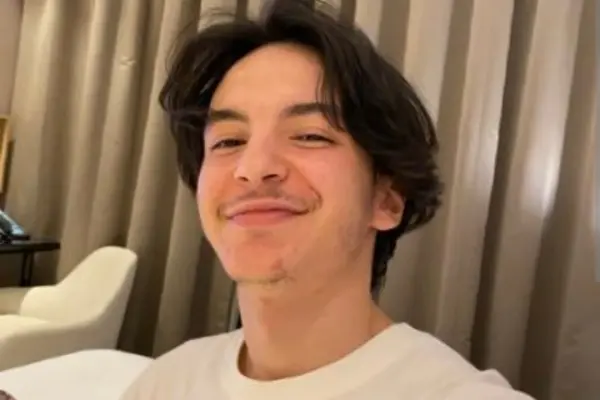Paperclip : le programme secret qui a conduit des scientifiques nazis aux États-Unis

Le 20 juillet 1969, une équipe d’astronautes américains réussit pour la première fois un alunissage. Bien que seuls trois astronautes se trouvaient à bord de la fusée spatiale, les cerveaux de milliers de personnes avaient permis leur fantastique voyage.
Parmi les contributeurs figuraient des scientifiques allemands qui avaient appartenu au parti nazi. Les États-Unis les avaient recrutés dans les années 1940, après la fin de la Seconde guerre mondiale, dans le cadre d’un programme fédéral, l’opération Paperclip.
L’inclusion d’anciens Nazis dans la vie américaine et au sein des institutions officielles reste un chapitre controversé de l’histoire des États-Unis.
L’OPÉRATION PAPERCLIP
Au printemps 1945, les forces alliées se rapprochaient de l’Allemagne nazie et la fin de la guerre en Europe était proche. Les autorités officielles commençaient à imaginer ce à quoi l’Après-guerre allait ressembler. Et, dans leurs plans, il fallait s’assurer de garder certains scientifiques allemands pour contribuer au progrès technologique américain.
Après tout, les États-Unis étaient aussi effrayés qu’impressionnés par la suprématie technologique que l’Allemagne avait démontré durant la guerre. Ils se préparaient à la nouvelle génération de Wunderwaffen, les « armes miraculeuses », et entendaient des rapports sur des armes d’une précision mortelle, comme la bombe V1 et le missile balistique V2.
Washington craignait que la France ou que l’Union soviétique ne mettent la main sur les meilleurs scientifiques allemands, surtout aux premières heures de la Guerre froide. « Pour empêcher les Soviétiques de récupérer les scientifiques, les États-Unis devaient les garder avec eux », explique Brian Crim, professeur d’Histoire de l’université de Lynchburg. Les Américains attiraient les scientifiques qui travaillaient auparavant avec le parti nazi avec des promesses de contrats et de foyers aux États-Unis.
L’opération Paperclip était dirigée par la Joint Intelligence Objectives Agency. Leur espoir était de se servir de l’expertise technologique de ces scientifiques afin de développer les programmes aéronautiques, militaires et spatiaux des États-Unis. L’opération Paperclip a officiellement pris fin en 1947 mais continua par le biais de programmes similaires jusqu’en 1962. En tout, 1 500 scientifiques allemands et autrichiens furent ramenés sous la bannière des États-Unis et la plupart d’entre eux furent naturalisés par la suite.
Pour déterminer quels scientifiques recruter, les Américains se sont reposés sur une liste de 15 000 scientifiques constituée par l’ingénieur allemand Werner Osenberg durant la guerre. Alors que la panique montait du côté allemand au vu de l’avancée des troupes alliées en 1945, ils tentèrent de se débarrasser de cette liste en la jetant dans les toilettes de l’université de Bonn. Les documents à moitié détruits furent tout de même récupérés par les États-Unis, qui s’en servirent pour faire leur choix.
POURQUOI « PAPERCLIP » ?
Le nom de cette opération vient du fait que des trombones (en anglais, paperclip) étaient utilisés comme marque-pages pour repérer les dossiers des candidats. Selon le livre du journaliste Eric Lichtblau, The Nazis Next Door: How America Became a Safe Haven for Hitler's Men, qui n’a pas été traduit en français, les recruteurs vérifiaient les dossiers des scientifiques pour apprendre s’ils faisaient partie du parti nazi ou s’ils adhéraient à ses idées, au moins de manière officielle. Ils « plaçaient un trombone sur le haut des dossiers confidentiels des scientifiques qui les intéressaient », explique Brian Crim.
« C’était pour indiquer aux enquêteurs que les scientifiques ne devaient faire l’objet que d’une enquête superficielle. La plupart des scientifiques étaient des membres du parti nazi ou appartenaient à des organisations nazies prohibées comme la Schutzstaffel ou les SS. Le trombone annonçait clairement “N’y regardez pas de trop près. Ce gars-là est pour nous”. »
Bien qu’aucune agence américaine n’ait publiquement confirmé le procédé de recrutement de l’opération Paperclip, des enquêtes indépendantes menées par des scientifiques et des journalistes avaient soulevé des questions quant au passé de certains scientifiques impliqués.
LA COURSE À LA CONQUÊTE SPATIALE
Dans les années 1950 et 1960, le programme spatial américain s’accéléra, alors que les États-Unis et l’Union Soviétique se faisaient la course pour envoyer le premier Homme sur la Lune. Certains bénéficiaires de l’opération Paperclip aidèrent les Américains lors de cette course à l’espace.
Le scientifique allemand Wernher von Braun fut l’un d’entre eux. En Allemagne, son plus grand succès fut l’invention du missile balistique V2 qui pouvait atteindre des cibles sur de longues distances. Il avait aussi été un officier SS, l’organisation paramilitaire d’élite des Nazis.
D’abord stationnés à Fort Bliss, au Texas, puis à Huntsville, dans l’Alabama, von Braun et son équipe ont travaillé sur le développement de missiles pour l’armée américaine avant d’être transférés à la NASA en 1960. En tant que membre de la NASA, von Braun soutenait les efforts accomplis pour envoyer un homme sur la Lune. Il devint un porte-parole important de l’exploration spatiale.
D’autres anciens Nazis étaient impliqués dans le programme spatial, comme Kurt Debus, lui aussi un ancien membre des SS, qui devint le premier directeur du Centre spatial Kennedy. Hubertus Strughold fut l’un des pionniers de la recherche sur la médecine dans l’espace, et son rôle dans les expériences médicales sur des sujets incarcérés dans les camps de concentration durant la guerre fut minutieusement passé au crible après sa mort.
UN PROCÉDÉ DE RECRUTEMENT CONTROVERSÉ
Plusieurs des scientifiques qui ont passé les différentes phases de recrutement de l’opération Paperclip ont plus tard fait l’objet d’enquêtes minutieuses sur leurs activités durant la Seconde guerre mondiale.
Au cours de la guerre, Georg Rickhey était responsable de l’acquisition de travailleurs forcés à Mittelwerk, une usine souterraine de fabrication d’armes aux conditions notoirement brutales. Bien que l’opération Paperclip promettait initialement une nouvelle vie aux États-Unis à Rickhey, il fut extradé vers l’Allemagne de l’Ouest en 1947 afin d’être jugé pour des crimes de guerre desquels il fut acquitté.
D'autres scientifiques firent face à des enquêtes approfondies au cours des décennies qui suivirent.
« L’histoire publique de beaucoup de ces scientifiques a été blanchie depuis le début, mais quelques journalistes intrépides ont déterré certains détails du procédé de recrutement délibérément bâclé au cours des années 1970 et 1980 », explique Brian Crim.
Arthur Rudolph était l’un des subordonnés de Rickhey à Mittelwerk, où il supervisait la production de missiles. Aux États-Unis, Rudolph participa au développement de la fusée de lancement de Saturn V, ce qui permit la mission américaine vers la Lune en 1969.
Au début des années 1980, le Département de Justice des États-Unis a monté une instruction pour crimes de guerre à l’encontre d’Arthur Rudolph. Le scientifique dut ainsi renoncer à sa citoyenneté américaine et quitter le pays en 1984 pour éviter le procès.
UN HÉRITAGE COMPLIQUÉ
Les historiens tentent encore de comprendre le rôle crucial qu’ont joué les scientifiques de l’opération Paperclip dans la réussite du programme spatial américain.
« Je pense que la trace qu’ils ont laissé sur les sciences américaines n’est pas aussi profonde que ce que l’on pense », déclare Brian Crim, remarquant que « Wernher von Braun a économisé aux États-Unis quelques années de recherches et de développement pour ce qui est des missiles […] mais beaucoup d’experts remettent en question la nécessité de l’équipe qui travaillait sur les armements pour le programme spatial américain ».
Brian Crim souligne que le programme fait remonter des questions qui gênent sur la sécurité nationale et la naturalisation aux États-Unis. « Paperclip a récompensé des centaines de Nazis dévoués qui désiraient la citoyenneté américaine, des boulots d’excellence, alors même que le public saluait les survivants de l’Holocauste, qui étaient tenus à l’écart du pays. »
Ces questions éthiques jettent toujours une ombre sur le programme, renforcée par les détails qui continuent de refaire surface. Brian Crim s'interroge : « est-ce une justification que de s’accommoder d'une idéologie toxique quand on est scientifique ? Est-ce que la science est vraiment apolitique ? Paperclip est un cas d’étude, mais ce n’est certainement pas le seul. »
Quelle est votre réaction ?
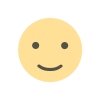 J'aime
0
J'aime
0
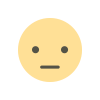 Solidaire
0
Solidaire
0
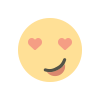 J'adore
0
J'adore
0
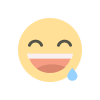 Drôle
0
Drôle
0
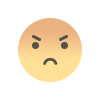 En colère
0
En colère
0
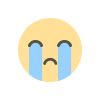 Triste
0
Triste
0
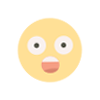 Wow
0
Wow
0