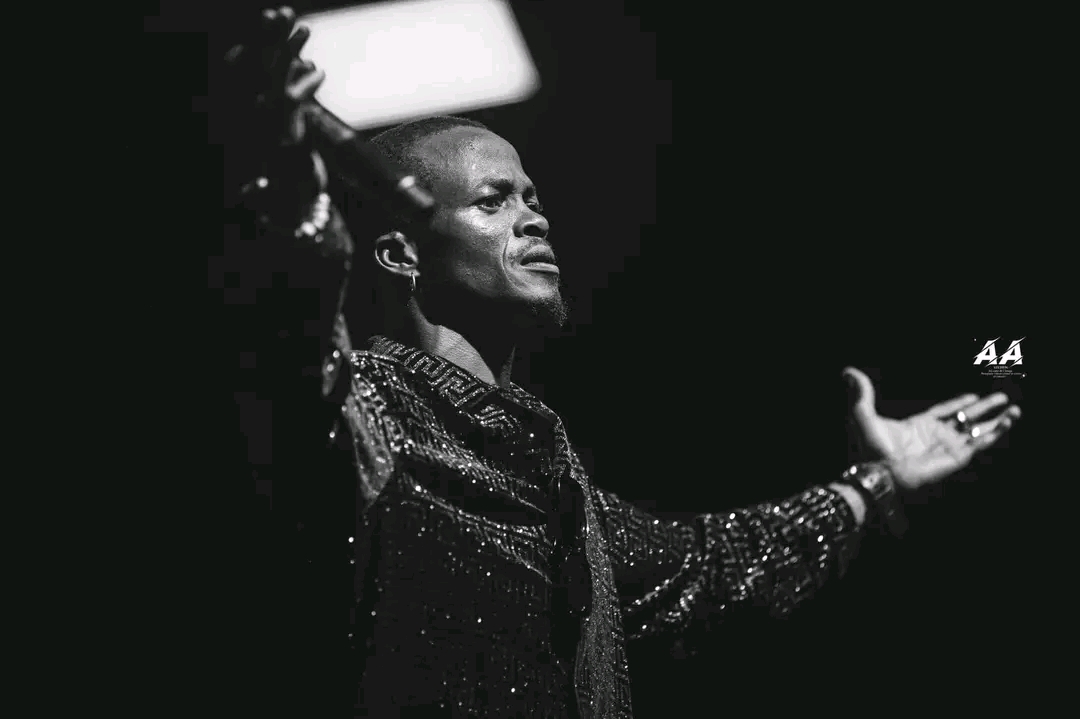Voici ce qu'il se passe dans votre cerveau à la ménopause

Peu après avoir franchi le cap des cinquante ans, Susan Shaw a remarqué que certaines choses commençaient à lui échapper : où elle avait garé sa voiture, à qui elle devait téléphoner, voire la date d’anniversaire de sa meilleure amie. Adepte du multitâche au travail, elle se sentait désormais déstabilisée par la moindre interruption. Cinq ans plus tard, le problème s’est aggravé.
« Mon cerveau ne fonctionne plus comme avant », soupire Susan Shaw. Elle compense en dressant des listes de tâches détaillées et en demandant à ses collègues de ne pas la déranger.
Heureusement, Susan ne craint pas que ses symptômes soient les signes d’une démence précoce. En tant qu’obstétricienne-gynécologue, elle sait que ces troubles cognitifs sont fréquents pendant la transition ménopausique.
Environ 41 % des femmes se plaignent de troubles de la mémoire à cette période. D’autres évoquent souvent un brouillard mental ou des difficultés à trouver leurs mots.
Les chercheurs spécialisés dans la ménopause documentent de plus en plus les modifications du cerveau, notamment la diminution du volume cérébral et la baisse du flux sanguin, susceptibles d’expliquer ces tourments. Ils tentent de relier ces changements cérébraux aux variations hormonales qui commencent plusieurs années avant la ménopause, au cours de la périménopause, et se poursuivent après la fin des menstruations.
« La ménopause n’est pas seulement un processus hormonal, c’est aussi une transition cérébrale. Il y a des changements structurels documentés dans le cerveau », explique Angélica Rodríguez, doctorante à la Ponce Health Sciences University (Porto Rico), qui a présenté une synthèse de ces recherches lors de la conférence annuelle de la Menopause Society à Orlando, en Floride.
Il y a dix ans, les femmes parlaient surtout de bouffées de chaleur et de sueurs nocturnes, mais aujourd’hui, « nous entendons beaucoup plus souvent parler de ces symptômes cognitifs », observe Susan Shaw, qui y voit à la fois l’effet de la recherche et d’une plus grande liberté de parole autour des transformations liées à la ménopause.
Pourtant, de nombreuses zones d’ombre subsistent, notamment parce que la recherche sur le cerveau des femmes reste sous-financée, rappelle Pauline Maki, spécialiste de la cognition féminine à l’Université de l’Illinois à Chicago.
DES ZONES DU CERVEAU IMPLIQUÉES DANS LA MÉMOIRE SE RÉTRÉCISSENT
La synthèse d'Angélica Rodríguez reprend cinq études majeures publiées entre 2020 et 2024. L’une d’elles, parue dans Scientific Reports, a combiné plusieurs types d’imagerie cérébrale chez plus de 150 femmes. Résultat : le volume du cortex cérébral, impliqué dans la mémoire, le traitement de l’information et d’autres fonctions cognitives, ainsi que la substance blanche qui relie les neurones, diminuent pendant la périménopause. Le flux sanguin cérébral baisse également.
D’autres études relient la ménopause à une réduction de l’hippocampe, région clé pour la mémoire et l’orientation spatiale.
La synthèse en question a aussi mis en évidence qu’avec le temps, la ménopause augmente la densité des récepteurs d’œstrogènes dans le cerveau, une élévation associée à une aggravation des troubles cognitifs.
L’âge de la ménopause pourrait aussi jouer un rôle. Les femmes dont les cycles cessent avant quarante-sept ans présentent plus souvent des lésions microscopiques des petits vaisseaux cérébraux, appelées hyperintensités de la substance blanche, que celles ménopausées après cinquante-cinq ans.
CHANGEMENTS HORMONAUX OU VIEILLISSEMENT ?
Une question essentielle demeure : ces altérations du cerveau proviennent-elles des fluctuations hormonales de la ménopause, ou du vieillissement naturel ?
On sait depuis longtemps que le volume cérébral diminue chez tout le monde après trente-cinq ans, et plus rapidement après soixante ans.
L’étude publiée dans Scientific Reports suggère que l’âge n’est pas le facteur clé, car ces changements n’étaient pas observés chez des hommes du même âge.
Mais une autre étude, présentée lors de la même conférence, n’a trouvé aucun lien entre le stade de la ménopause et le volume cérébral. Réalisée sur plus de 200 femmes d’âge moyen, elle a montré que certaines zones du cortex se contractaient, mais uniquement en corrélation avec l’âge.
« D’après nos recherches, la réponse à la question : le cerveau des femmes rétrécit-il pendant la ménopause ? est non. Les femmes présentent simplement les déclins liés à l’âge, non aggravés par la ménopause », affirme Katrina Wugalter, doctorante en psychologie à l’université de l’Illinois à Chicago.
Selon elle, les divergences avec les études précédentes tiennent au faible nombre de participantes ou à des critères de ménopause moins rigoureux, souvent fondés sur l’âge ou la mémoire des femmes plutôt que sur leurs cycles actuels.
Pour trancher définitivement la question, les scientifiques doivent suivre les mêmes femmes sur plusieurs années, un protocole longitudinal déjà lancé par la Women’s Brain Health Initiative de l’Université de Californie à Santa Barbara.
LA PLUPART DES CHANGEMENTS NE SONT PAS LIÉS À ALZHEIMER
Beaucoup de femmes craignent que leurs oublis soient le signe précoce d’une démence. En réalité, ces symptômes sont courants mais transitoires, assure Emily Jacobs, neuroscientifique et responsable de l’initiative de l'université de Californie. Son équipe a préalablement documenté les changements cérébraux observables durant la grossesse et a décidé de mener des observations similaires pour la période ménopausique.
Chaque femme traverse la ménopause, souligne-t-elle, mais seules 20 % développeront la maladie d’Alzheimer. « Les symptômes neurologiques de la ménopause sont fréquents et temporaires, et rarement inquiétants », précise-t-elle.
Un groupe de femmes, toutefois, pourrait être plus à risque : celles qui terminent leur ménopause avant quarante ans, qui présentent 35 % de risques supplémentaires de développer une démence au cours de leur vie, selon la vaste étude britannique UK Biobank, menée sur plus de 150 000 femmes.
Un second groupe pourrait être constitué de femmes souffrant de bouffées de chaleur sévères, corrélées à une augmentation des hyperintensités de la substance blanche dans une petite étude menée par Pauline Maki.
L’HORMONOTHÉRAPIE PEUT-ELLE AIDER ?
On ignore encore si l’hormonothérapie ménopausique (MHT), souvent prescrite contre les bouffées de chaleur, peut améliorer la cognition ou freiner les changements cérébraux.
Aucune étude clinique randomisée n’a testé la MHT spécifiquement pour la cognition. Elle ne doit donc pas être prescrite dans ce but, précise Pauline Maki. Toutefois, certaines patientes traitées pour les symptômes vasomoteurs pourraient bénéficier d’un effet cognitif secondaire.
Les femmes plus jeunes en ménopause chirurgicale (après ablation de l’utérus et des ovaires) pourraient en tirer un bénéfice particulier, selon les travaux préliminaires de Pauline Maki. Mais là encore, les mécanismes restent obscurs.
Selon Emily Jacobs, les effets varient fortement : son étude sur les participantes de la UK Biobank montre que les utilisatrices actuelles d’hormonothérapie, ou celles qui l’ont arrêtée tardivement, présentent un volume cérébral moindre, alors que celles sous traitement après hystérectomie ont un volume plus élevé, signe d’un cerveau « plus jeune ».
« Ce que montre cette étude, c’est que c’est compliqué. Il n’y a pas de réponse universelle à l’hormonothérapie ménopausique », conclut-elle.
LES CHANGEMENTS SONT-ILS PERMANENTS ?
Dernière grande question : les changements cérébraux et cognitifs disparaissent-ils une fois la ménopause achevée ?
Dans l'étude parue dans Scientific Reports, les chercheurs ont trouvé des niveaux normaux de matière grise et de flux sanguin chez les femmes post-ménopause, mais une diminution persistante de la substance blanche.
Côté symptômes, certains scientifiques parlent d’une phase de transition, mais Angélica Rodríguez souligne que de nombreuses femmes âgées affirment encore souffrir de certains symptômes.
« Nous avons une bonne compréhension des processus hormonaux de la ménopause, mais pas assez de ceux qui concernent le cerveau, » dit-elle. « Il est essentiel de relier les deux pour comprendre l’ensemble du phénomène. »