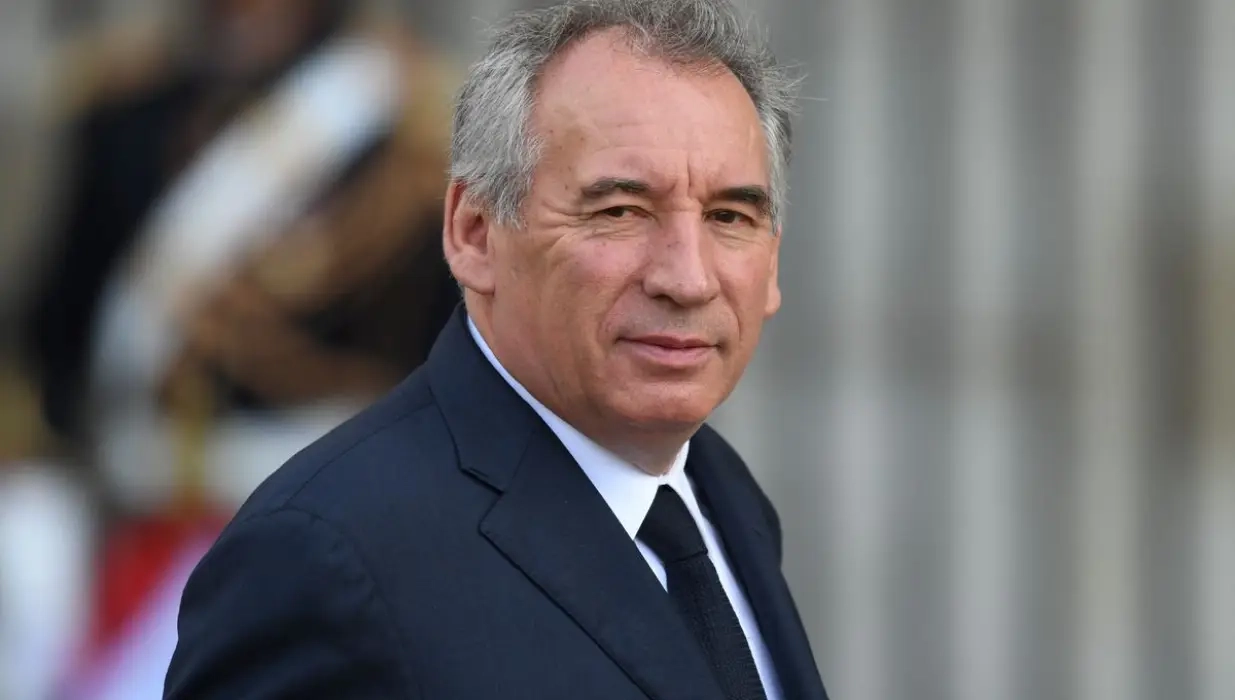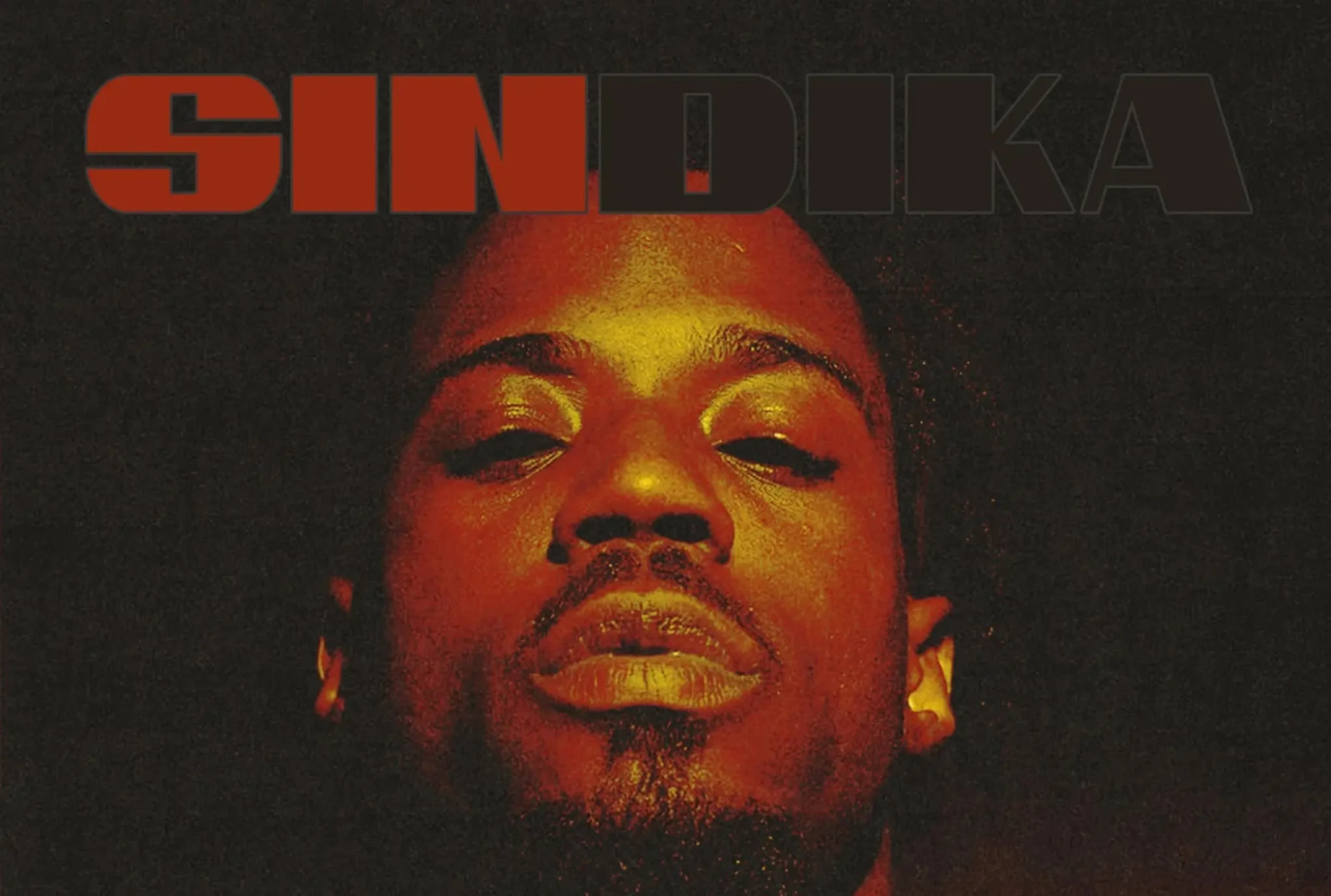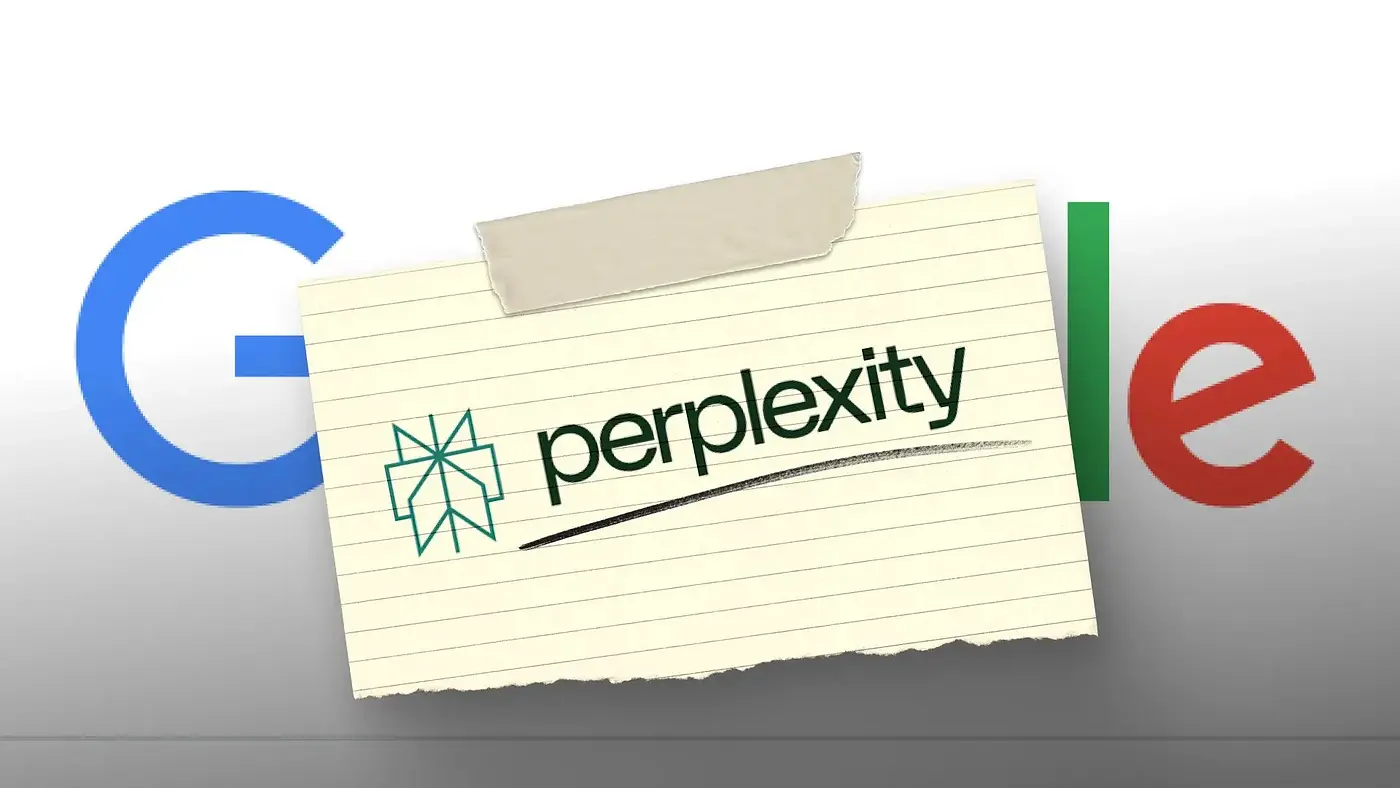Il serait possible de détecter Alzheimer dès l'âge de vingt ans

Il y a plus d’un siècle, un neuro-anatomiste allemand a remarqué que sa patiente agissait de manière anormalement confuse. Après sa mort, Alois Alzheimer a examiné son cerveau et a découvert des plaques de bêta-amyloïdes ainsi que des « enchevêtrements » neurofibrillaires, deux caractéristiques clés de ce que l’on appelle à présent la maladie d’Alzheimer.
Aujourd’hui, nous savons que ces plaques et ces enchevêtrements interfèrent avec nos fonctions cérébrales normales ; nos neurones meurent, les malades commencent à oublier, à perdre la mémoire. Dans les derniers stades de la maladie, Alzheimer est incurable. Cependant, les dommages peuvent être ralentis s’ils sont découverts suffisamment tôt.
Une nouvelle étude révèle, avec précaution, qu’il pourrait être possible de détecter les signes révélateurs d’Alzheimer plus tôt qu'on ne le pensait possible auparavant, dès la vingtaine ou la trentaine. Sachant que le nombre de personnes atteintes d’Alzheimer pourrait doubler d’ici 2060 selon les prévisions d’Alzheimer Europe, cela pourrait changer la donne.
« Un neurone mort le restera pour toujours. Il faut se tourner vers la médecine préventive », déclare Lilian Calderón-Garcidueñas, professeure à l’université du Montana, au sein de la faculté de sciences pharmaceutiques et biomédicales, qui n’a pas pris part à la nouvelle étude. Elle confie cependant que les découvertes coïncident avec celles de son équipe sur la détection précoce d’Alzheimer.
« La clé est la tranche d’âge étudiée : les jeunes adultes », insiste la professeure. « La plupart des chercheurs aux États-Unis se concentrent sur les populations âgées. »
Les scientifiques ont réalisé des avancées et des percées dans les diagnostics précis et rapides d’Alzheimer. Après tout, avant les années 2000, les médecins n’étaient pas capables de diagnostiquer cette maladie avant qu’elle n’entraîne la mort. Il est à présent de notoriété publique que les cerveaux montrent des signes d’Alzheimer des décennies avant que les symptômes n’apparaissent, un laps de temps que cette recherche vise à élargir encore plus.
« Je me suis rendu compte que nous devions vraiment étudier la maladie plus tôt », confie Allison Aiello, professeure d’épidémiologie à l’université Columbia et chercheuse principale de la nouvelle étude. « Nous avions effectivement observé certaines associations au cours des stades précoces. Cela m’a assez surprise. »
POURQUOI LE DIAGNOSTIC D’ALZHEIMER EST SI COMPLEXE CHEZ LES JEUNES CERVEAUX ?
De nos jours, les diagnostics et la détection de risques reposent sur la présence de biomarqueurs particuliers, comme des enchevêtrements neurofibrillaires de protéines tau et des plaques de bêta-amyloïdes. Cela ne garantit cependant pas qu’une personne deviendra symptomatique, les cliniciens cherchent donc des preuves de déclin cognitif. Certains tests standards, comme demander à un patient de se rappeler une liste de mots, peuvent permettre de mesurer la cognition.
En outre, il existe de multiples causes sous-jacentes et de facteurs de risque qui peuvent varier selon les personnes. Afin d’évaluer plus précisément les risques de démence, les cliniciens ont recours à des outils tels que le score CAIDE (de l’anglais Cardiovascular Risk Factors, Aging and Incidence of Dementia, ou facteurs de risque cardiovasculaire, âge et incidence de la démence en français), qui prend en compte les facteurs de risque liés à l’indice de masse corporelle, l’âge et l’éducation. Il fournit ensuite un « score de risque » : plus il est élevé, plus le risque l’est également.
Étant donné que la maladie d’Alzheimer se manifeste surtout chez les personnes de plus de 65 ans, il subsiste un « scepticisme [historique] dans le domaine [quant à] la mesure de la fonction cognitive plus tôt dans la vie », constate Allison Aiello, surtout avant la quarantaine.
Mais la chercheuse était curieuse et a vu l’opportunité d’étudier ce problème se présenter lorsqu’elle a rejoint l’étude longitudinale américaine de la santé de l’adolescence à l’âge adulte. Cette étude monumentale impliquait à l’origine 20 000 collégiens et lycéens en 1994 et 1995 et est toujours en cours. Il s’agit de la plus grande étude longitudinale menée aux États-Unis.
En 2008, alors que les âges des participants allaient de vingt-quatre à trente-quatre ans, l’équipe d’Allison Aiello a conduit des centaines de tests, dont la vérification de la cognition de 11 500 participants et la prise de 4 500 échantillons sanguins. Près d’une décennie plus tard, l’équipe a mené d’autres tests cognitifs et génétiques.
Les découvertes ont révélé des signes de déclin cognitif dès l’âge de vingt-quatre ans, et certains indicateurs biologiques de risque neurodégénératif chez les participants de plus de trente ans. Pour être plus précis, les chercheurs ont analysé les interleukines 6 et 8, des biomarqueurs d’inflammation, dans les échantillons sanguins. Lorsque les participants avaient entre trente-quatre et quarante-quatre ans, ces biomarqueurs étaient associés à des scores plus bas aux tests cognitifs. L’équipe a également découvert que les scores de risque CAIDE plus élevés étaient liés à des scores cognitifs bas dès vingt-cinq ans, soit bien avant quarante ans, au moment où les facteurs de risque sont généralement évalués.
« Cette étude est un grand succès », affirme Tatjana Rundek, à la tête de l’Institut Evelyn F. McKnight d’études cérébrales de l’université de Miami, qui n’a pas pris part à l’étude. Bien que l’ampleur de l’effet soit petite et que les associations soient subtiles, elle fournit tout de même « un soutien moléculaire convaincant des neuroinflammations et neurodégénérescences précoces ».
LIMITES DE L’ÉTUDE
Cependant, certains experts font preuve de plus de retenue. Malgré sa validation, Tatjana Rundek explique que le score CAIDE n’offre pas un diagnostic définitif d’Alzheimer, surtout au vu de la diversité de la population.
Et, selon Sharon Sha, professeure de neurologie et cheffe de la division des troubles de la mémoire à l’université de Stanford, certains des biomarqueurs découverts ne sont pas exclusifs à la maladie d’Alzheimer.
Sharon Sha fait remarquer que l’étude a mesuré le « total de protéine tau » au lieu de se concentrer sur les protéines tau phosphorylées. Si le total de tau peut être indicateur de neurodégénérescence, de plus en plus de recherches révèlent que les protéines tau phosphorylées sont plus propres à Alzheimer.
Elle déclare toutefois être « d’accord pour dire que les résultats découverts sont de potentiels facteurs de risque pour un futur déclin cognitif, de déficience cardiovasculaire ou vasculaire. »
Allison Aiello a également reconnu la nécessité de conduire plus de recherches, ce qui ne saurait tarder. D’autres scientifiques au Royaume-Uni ont mené des études qui suivaient le cours de la vie de leurs participants, partage Allison Aiello. « Je pense que nous verrons de plus en plus de ces études à l’avenir. »
Sa propre équipe continue de suivre cette cohorte afin de voir comment les risques de développer la maladie d’Alzheimer évoluent au cours du temps. Lorsque les participants entreront dans la dernière vague, entre trente-neuf et quarante-neuf ans, ils feront l’objet de tests pour mesurer leurs capacités cognitives et leurs fonctions physiques et sensorielles, comme l’ouïe ou la force. L’analyse des données est prévue et les résultats devraient être publiés en 2026.
L’AVENIR DE LA RECHERCHE SUR ALZHEIMER
Les détections précoces peuvent redonner du courage aux patients. Les personnes qui présentent un plus grand risque peuvent commencer à changer leur mode de vie, et certaines interventions saines peuvent aider à prévenir ou ralentir le développement des cas de démence, jusqu’à 40 %. Les traitements médicaux d’Alzheimer actuels, comme le lecanemab, ralentissent également le déclin, cependant à partir d’un stade un peu plus avancé de la maladie. « Le plus tôt c’est le mieux, non ? » remarque Allison Aiello.
En conséquence, la détection précoce reste un sujet de recherches sensible. En 2023, des chercheurs ont publié une étude qui suggérait avec précaution que les yeux avaient le potentiel de prédire les risques précoces d’Alzheimer. Une autre étude parue en 2024 dans la revue scientifique Nature Aging a révélé qu’un modèle entraîné par IA pouvait déceler Alzheimer sept ans avant l’apparition des symptômes, et identifiait des schémas et des facteurs de risque surprenants.
Le modèle a suggéré que l’ostéoporose pouvait être un facteur de risque d’Alzheimer chez les femmes. Bien que cela ne signifie pas qu’une femme souffrant d’ostéoporose développera avec certitude Alzheimer, « nous observons ces relations », explique Alice Tang, étudiante en médecine et doctorante de l’université de Californie à San Francisco, qui a mené l’étude. « Et cela nous a conduit à nous poser plus de questions et à mener de meilleures études en fin de compte. »
Les possibilités de recherches telles que celles-ci pourraient bientôt aider les scientifiques à développer des modèles plus significatifs pour détecter Alzheimer dans ses stades précoces. Dans son propre travail, Allison Aiello est impatiente de voir ce que peuvent révéler la sixième vague de l’étude longitudinale. « Je pense qu’il va être vraiment exaltant pour les chercheurs de décortiquer avec soin ces associations beaucoup plus tôt dans la vie, et d’une manière plus poussée. »