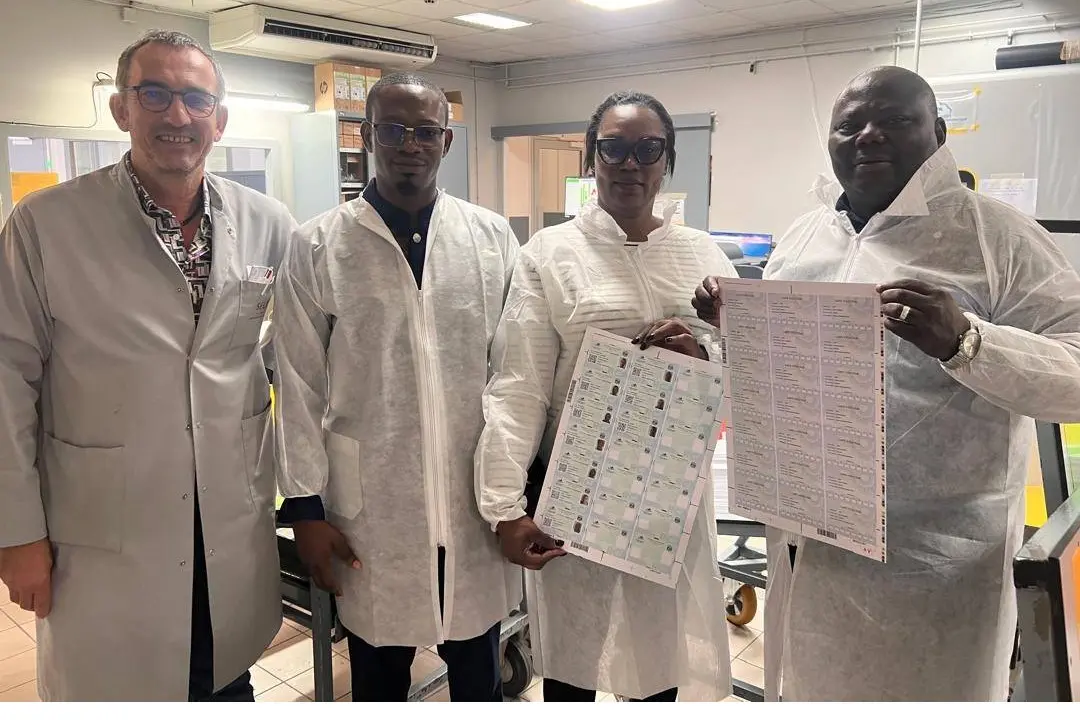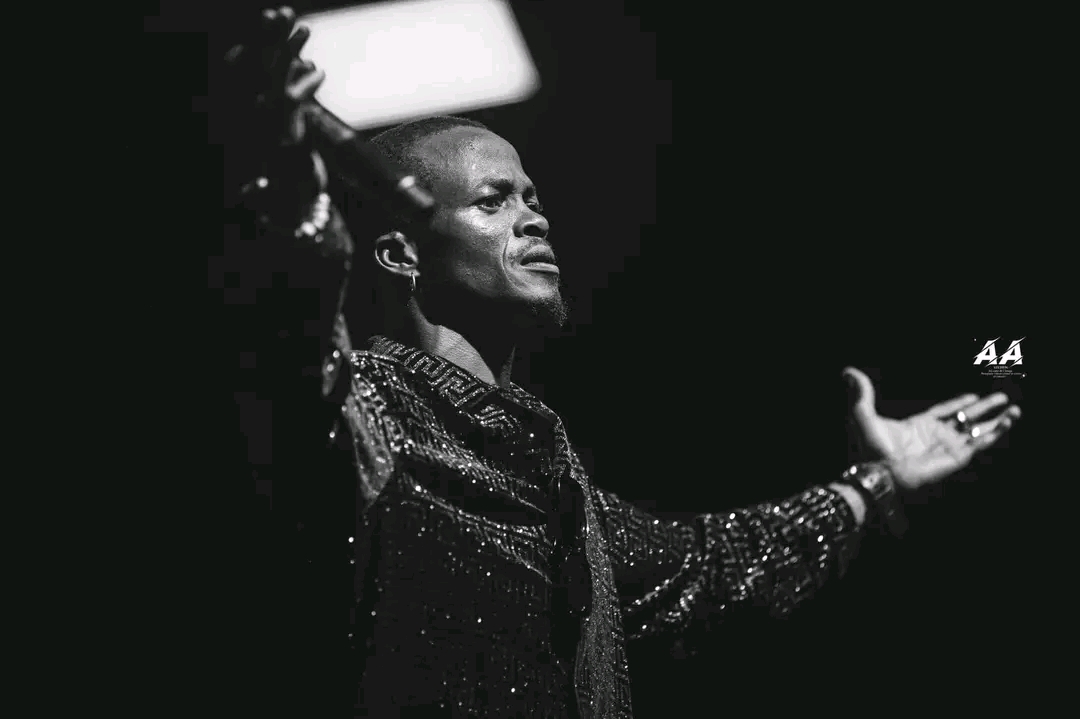L’héritage des missions Apollo : la conquête de la Lune, entre ambitions et sacrifices

Le 4 octobre 1957, en pleine guerre froide, le lancement par les Soviétiques de Spoutnik 1, premier satellite artificiel, déclencha une compétition historique. Ce satellite flottant au-dessus de leur tête devint pour les Américains une humiliation doublée d’un défi. Blessée dans son orgueil, l’Amérique n’eut désormais qu’un seul but : devancer les Soviétiques. En 1961, après le vol orbital de Youri Gagarine, John Fitzgerald Kennedy annonça devant le Congrès américain : « Nous avons l’obligation de démontrer la supériorité américaine en envoyant, quoi qu’il en coûte, un homme sur la Lune avant la fin de la décennie ».
Ainsi débuta le programme Apollo, précédé des missions Mercury et Gemini. Contrairement à une idée reçue, Apollo ne fut pas le premier programme de conquête spatiale américaine, mais l’aboutissement de décennies de recherches et d’efforts.
Les chercheurs de la NASA faisaient face à un défi technique colossal : concevoir des fusées capables d’aller sur la Lune et d’en revenir. Des milliers de personnes furent mobilisées. Le programme Mercury, avec les vols d’Alan Shepard et Gus Grissom furent des succès, malgré un incident lors de l’amerrissage de ce dernier, dû à une défaillance de l’écoutille qui explosa. Ce dysfonctionnement, au cœur des préoccupations pour les conceptions futures, aura des conséquences.
La recherche et la course contre la montre se poursuivirent. Le lancement de Saturn 1, le 27 octobre 1961 marqua une nouvelle étape du programme spatial américain. Ce lanceur de Wernher von Braun, conçu pour orbiter autour de la Terre, évolua jusqu’au puissant Saturn V lancé le 9 novembre 1967.
Le programme Gemini, débuté en septembre 1962, devait permettre de perfectionner les manœuvres des engins spatiaux et de s’assurer de la survie des équipages en missions prolongées. Mais, le 18 mars 1965, nouveau revers pour les États-Unis : l’astronaute russe Alexeï Leonov réalisa la première sortie extravéhiculaire dans l’espace. La pression sur la NASA, déjà forte, s’intensifia, entraînant la décision d’envoyer un équipage, Ed White et James McDivitt, pendant quatre jours dans l’espace. Ainsi, le 3 juin 1965, leur vaisseau effectua 62 tours autour de la Terre et Ed White réalisa la première sortie extravéhiculaire américaine. Pour la première fois, les Américains prenaient une longueur d’avance sur les Soviétiques, confirmant qu’il était possible d’aller dans l’espace plusieurs jours et d’en revenir. La Lune était enfin à portée de main.
UN DRAME EN HÉRITAGE
Les Soviétiques, conscients de devoir accélérer, posèrent la première sonde inhabitée sur le sol lunaire le 3 février 1966. Le destin se mit alors en marche. Craignant d’être à nouveau dépassée par les Soviétiques, la NASA se hâta de développer la capsule Apollo, le premier engin conçu pour trois astronautes. Celui-ci présentait de nombreux problèmes, notamment au niveau du module de commande et du câblage, mais l’injonction de « faire mieux, plus vite, et à tout prix » créait un climat de tension et d’anxiété tels qu’on ne s’éternisa pas sur ces problèmes. Face à d’incessantes demandes de modifications, le projet devenait instable et les délais intenables, alors que la date de lancement d’Apollo 1 approchait.
Le 27 janvier 1967, lors d’un test, l’équipage d’Apollo 1, composé de Gus Grissom, Ed White et Roger Chaffee, signala des anomalies. La communication, quasi inaudible, ne permit pas au centre de contrôle de comprendre ce qui se passait, notamment l’alerte donnée par l’équipage sur ces problèmes de communication et au niveau des câbles. Soudain, un hurlement signala un incendie dans le cockpit. Les efforts déployés par six ingénieurs pour ouvrir l’écoutille de la capsule en feu (dont la conception et la résistance avaient été revues) furent vains, et depuis l’intérieur du vaisseau, plus aucune réponse ne parvenait aux appels désespérés du centre de contrôle.
L’enquête révéla que les astronautes respiraient de l’oxygène pur, hautement inflammable. L’incendie avait été causé par une simple étincelle sur des matériaux qui l’étaient tout autant, notamment le velcro et les câbles en mousse. Les conclusions de l’enquête furent cruciales pour comprendre les raisons de ce drame - considéré comme la plus grande catastrophe de l’histoire de l’aéronautique américaine – et pour la poursuite du programme. Alors que tout était à reconstruire, que le chagrin était immense et le deuil impossible, la pression sur la NASA ne faiblissait pas.
CAP SUR LA LUNE, L’INCROYABLE ACCÉLÉRATION
En dépit de cet effondrement – ou grâce à lui ? – le programme reprit et l’impossible devint possible. Le 11 octobre 1968, le premier vol habité, Apollo 7, fut réalisé, suivi d’Apollo 8 en décembre, qui vit orbiter trois hommes autour de la Lune. Au printemps 1969, Apollo 9 réalisa le premier essai d’amarrage en orbite terrestre et Apollo 10 s’approcha à moins de 15 km de la surface lunaire. Ces missions devinrent en quelque sorte des répétitions générales : le 20 juillet 1969, le monde entier assista à l’alunissage d’Apollo 11. Neil Armstrong, premier homme à marcher sur la Lune, prononça une phrase qui restera gravée dans l’histoire.
Les missions ultérieures se concentrèrent sur l’exploration lunaire, et c’est au cours de l’une d’elles qu’une plaque commémorative fut déposée en hommage à l’équipage d’Apollo 1. Leur sacrifice a peut-être permis de réaliser « un petit pas pour l’homme, et un pas de géant pour l’humanité ».