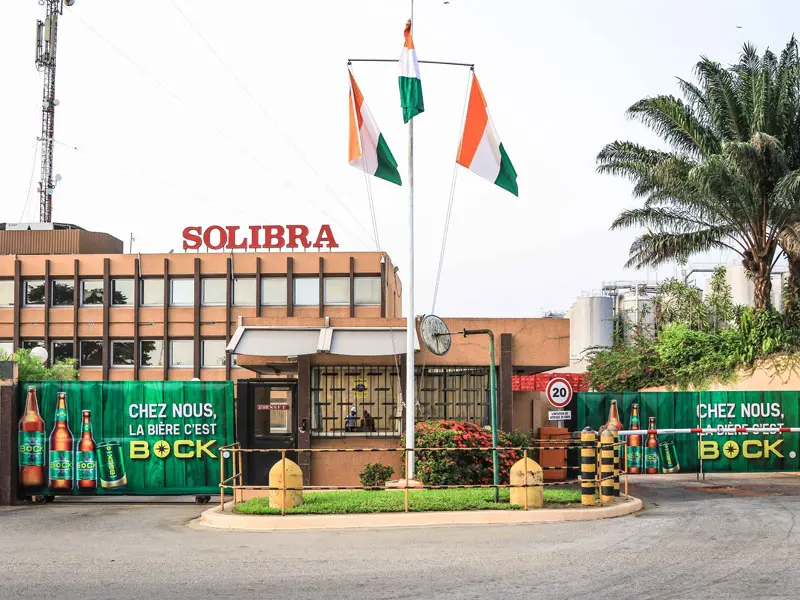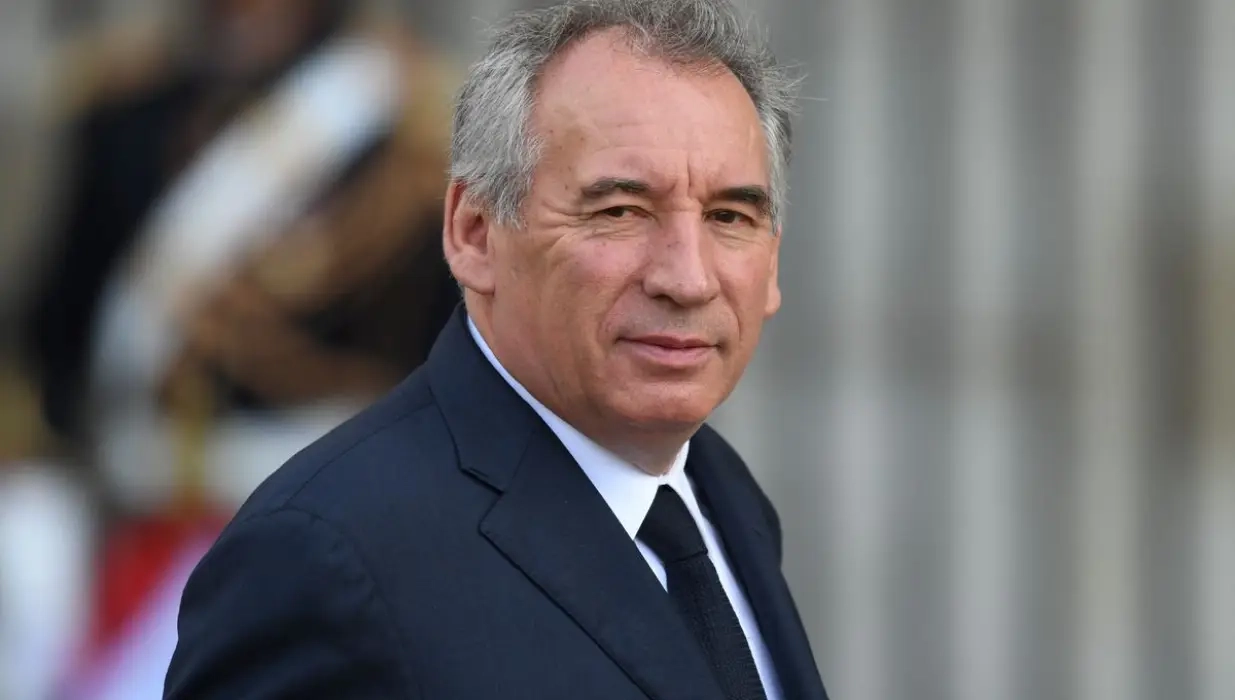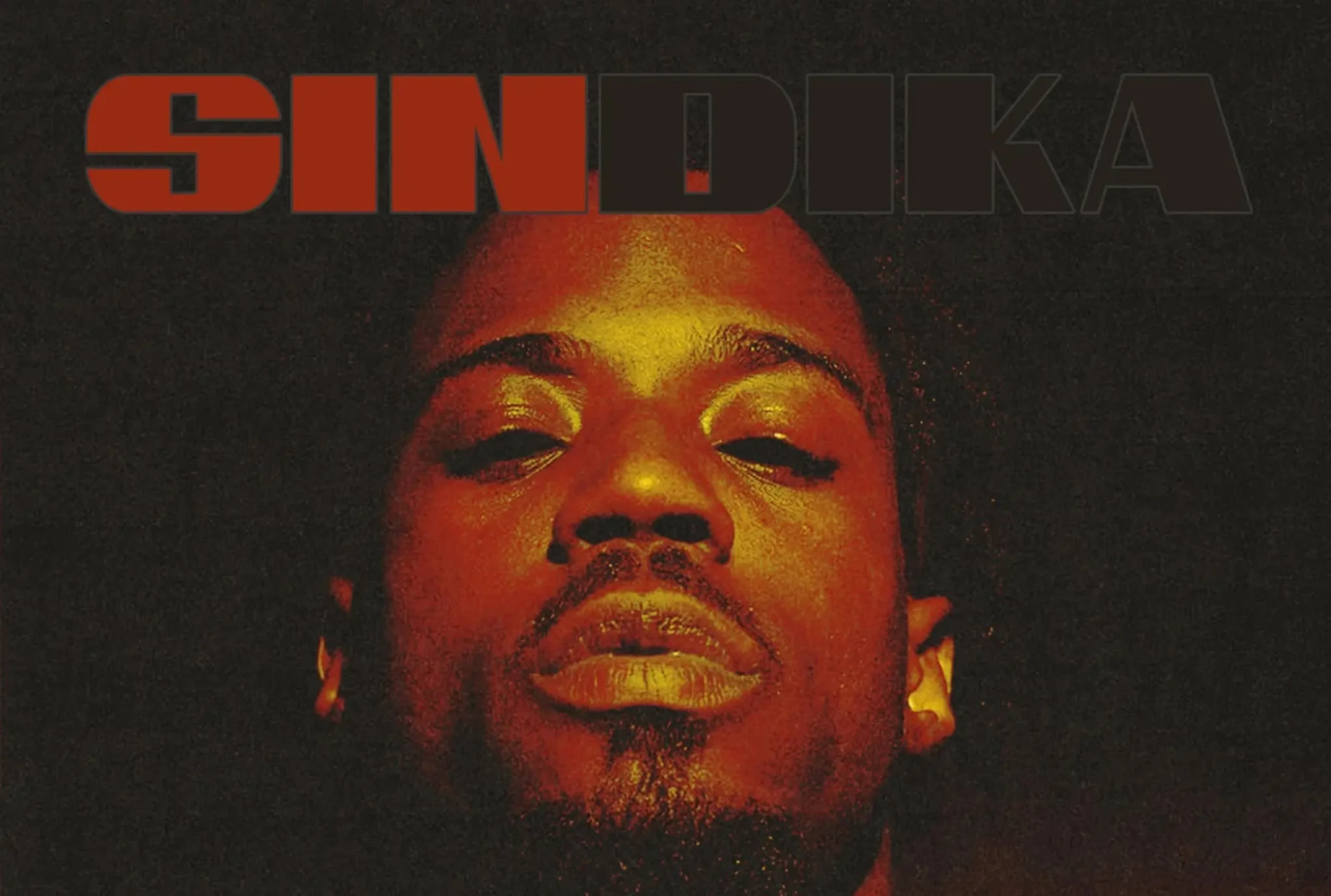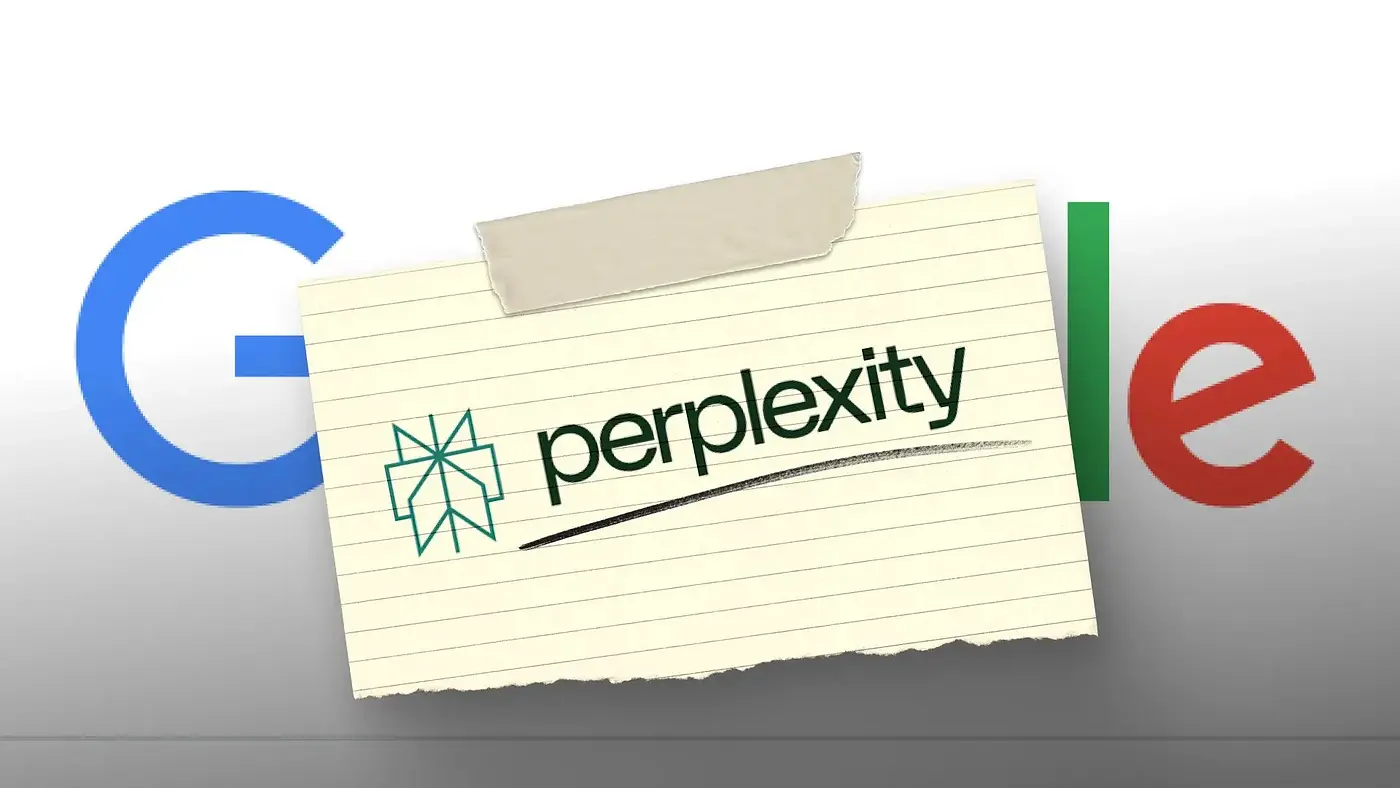L’océan s'assombrit (et c'est un problème)

Alors que 2025 a été proclamée année de la Mer et que la Troisième Conférence des Nations unies sur l’Océan vient tout juste de s’achever, les enjeux climatiques liés aux milieux marins s’imposent plus que jamais dans l’actualité.
Une étude parue dans la revue Global Change Biology révèle qu’une surface océanique de plus de 75 millions de kilomètres carrés, soit 21 % de l’océan mondial, aurait connu un assombrissement significatif entre 2003 et 2022.
Le changement de couleur de l’océan est un phénomène naturel, qui évolue selon les saisons et les régions, en grande partie sous l’effet de la prolifération du plancton. Ces micro-organismes marins, végétaux (phytoplancton) ou animaux (zooplancton), dérivent au gré des courants. Ils représentent environ 98 % de la biomasse océanique, produisent la moitié de l’oxygène que nous respirons et constituent la base de la chaîne alimentaire marine pour d’innombrables espèces.
Selon l’étude, l’assombrissement de l’océan serait lié à l’amincissement de sa zone photique, cette couche d’eau où la lumière du soleil et de la lune pénètre encore suffisamment pour permettre la photosynthèse. Cette zone, qui peut s’étendre jusqu’à 200 mètres de profondeur, abrite 90 % de la vie marine et figure parmi les habitats les plus riches de la planète.
La réduction de la profondeur de la zone photique correspond à une perte d’habitat majeure pour la vie marine, qui dépend de la lumière pour vivre et se reproduire. Le phénomène concerne principalement les régions côtières, mais affecte aussi les grands bassins océaniques.
Plusieurs facteurs ont été mis en cause dans l’étude, tels que l’apport accru de nutriments, de matière organique et de sédiments près des côtes, ainsi que de possibles modifications de la circulation océanique mondiale. Ils seraient responsables d’une augmentation de la production primaire et secondaire, limitant la pénétration de la lumière en surface.
UN MÉLANGE DE BLEU, DE VERT ET DE BRUN
Vincent Doumeizel, conseiller pour les océans aux Nations unies et auteur du livre Le manifeste du plancton, rappelle que « les planctons et la vie microscopique ont toujours été responsables de la couleur des océans. Les océans sont bleus parce que l’eau absorbe la lumière bleue et rejette toutes les autres, mais dès qu’il y a des planctons, leur présence modifie cette couleur ». Selon lui, ce phénomène n’est pas nouveau : « il y a eu des phases où l’océan s’est assombri naturellement. Il y a eu des cycles, il y a plusieurs millions d’années, où on a eu des proliférations puis des rarifications de planctons ».
Pour Marc Sourisseau, chercheur à l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) et responsable du laboratoire d’écologie pélagique, l’assombrissement des océans n’a rien de surprenant. Il rappelle notamment l’existence d’études antérieures portant sur les phénomènes de greening et de browning, qui contribuent largement à l’obscurcissement de l’eau. Le greening correspond à « une augmentation de la chlorophylle en surface », provoquée par « des changements dans l’épaisseur de la couche de mélange, liés à la stratification, [elle-même] due à l’augmentation de la température ». Des variations de circulation océanique peuvent également en être à l’origine.
Le browning, quant à lui, correspond à « une augmentation des matières brunes transportées par les rivières et les panaches », conséquence de « modifications dans l’exploitation des bassins versants », explique le chercheur. « Les activités humaines sur les littoraux entraînent des panaches fluviaux plus chargés en matière en suspension, ce qui accentue la turbidité et la coloration des eaux côtières », poursuit-il.
Selon Marc Sourisseau, « ce mélange de vert (chlorophylle) et de brun (matières humiques) » se combine et contribue logiquement à l’assombrissement des océans à l’échelle globale. Trois processus majeurs limitent la pénétration de la lumière : « il y a l’eau, qui absorbe naturellement la lumière, le vert [de la chlorophylle], et enfin toutes les matières en suspension ainsi que les substances humiques, qui absorbent elles aussi cette lumière ».
L’INTENSITÉ LUMINEUSE BAISSE AU LARGE ET SUR LES CÔTES
La diminution de la lumière disponible est liée à la réduction de la zone photique de l’océan, c’est-à-dire la baisse de la profondeur jusqu’à laquelle les rayons lumineux peuvent pénétrer dans l’eau. Selon Vincent Doumeizel, « cette zone photique est importante parce que c’est là que tous les organismes photosynthétiques [qui ont besoin de lumière] vont se regrouper. […] C’est là que se concentre la vie dans les océans ». Au large, Marc Sourisseau explique que l’augmentation de la production primaire, c’est-à-dire le processus par lequel le phytoplancton capte l’énergie solaire pour produire de la matière vivante, contribue à cette réduction de la zone photique.
En haute mer, « il peut y avoir des profondeurs de mélange plus faibles, ou des quantités de sels nutritifs plus importantes qui remontent en surface à la fin de l’hiver, ce qui entraîne une production de chlorophylle plus élevée », souligne-t-il. La chlorophylle « est un pigment […] qui permet de réaliser la photosynthèse, [c’est-à-dire] de transformer des composés minéraux en matière organique utilisable. […] Dans les océans, toute la matière organique est produite [par le phytoplancton] dans la zone photique, et sert ensuite à alimenter le réseau trophique », autrement dit la chaîne alimentaire marine.
Selon le chercheur, « en hiver, l’océan n’est pas stratifié [au large] : température et densité sont homogènes sur toute la colonne d’eau, au moins jusqu’à 200 mètres de profondeur. [Cela permet aux] sels nutritifs présents en profondeur de remonter vers la surface. […] Au printemps, l’augmentation du rayonnement solaire réchauffe la couche d’eau superficielle, qui s’isole progressivement des couches plus profondes. Le [phytoplancton] présent dans cette couche éclairée peut alors se développer », ce qui aurait été moins efficace si la colonne d’eau était restée complètement homogène.
Pour Marc Sourisseau, « on a deux tendances opposées : au large, une augmentation de la chlorophylle, et près des côtes, une baisse. Mais dans le même temps, on constate aussi une augmentation de la turbidité [de l’eau dans les zones côtières], qui [contribue] à son assombrissement », et qui peut être liée à des changements dans les pratiques agricoles.
Vincent Doumeizel affirme que l’assombrissement des océans est « la conséquence directe de l’eutrophisation. […] Les causes les plus graves sont sur la zone côtière, qui reçoit l’essentiel des impacts humains. […] Les excès de nutriments et de polluants vont avoir pour conséquence de nourrir certains types de phytoplancton, qui vont proliférer en surface et assombrir les océans ».
La gestion des rivières, des engrais et des eaux usées joue un rôle clé dans cette turbidité côtière. Marc Sourisseau estime que « l’on arrive quand même à contrôler [ces facteurs au niveau des côtes] » et que « tout n’est pas non plus piloté par les processus globaux. […] Quand on réduit nos apports en sels nutritifs, en nutriments apportés par les fleuves, on a tendance à voir une baisse de la quantité de chlorophylle en surface. […] Nous, sur la partie France métropolitaine, on est plutôt sur un [éclaircissement] de la couleur de l’eau […] depuis maintenant une dizaine ou quinzaine d’années ». Selon l’étude, dans d’autres régions, environ 10 % de la surface océanique se serait également éclaircie au cours des vingt dernières années, notamment dans une vaste zone de l’océan Atlantique. Les causes d'un tel phénomène restent encore à élucider.
LES CONSÉQUENCES SUR LES ÉCOSYSTÈMES MARINS ET LE CLIMAT
Les auteurs rappellent que « la diversité et l’interaction complexe de ces facteurs rendent toute quantification exhaustive des causes de l’assombrissement extrêmement difficile et hors du périmètre de cette étude ». Marc Sourisseau explique que les algorithmes interprétant les données satellitaires utilisés lors de l’étude ont été appliqués à l’échelle globale, « parce qu’ils ne pouvaient pas traiter des jeux de données trop hétérogènes ». Or, selon lui, « on a besoin d’algorithmes très spécifiques pour calculer la couleur de l’eau dans chaque région ». Cela constituera une prochaine étape dans l’approfondissement de cette problématique mondiale émergente.
Pour le chercheur de l’Ifremer, l’originalité de l’étude tient à l’analyse de l’impact des variations de l’intensité lumineuse sur la profondeur de la zone photique. Sur plus de 9 % de la surface océanique mondiale, l’assombrissement est particulièrement marqué, avec une réduction de la zone photique d’au moins 50 mètres. Pour 2,6 % de cette surface, la perte dépasse même 100 mètres.
Ces diminutions entraînent une réelle perte d’habitat pour de nombreuses espèces marines. Certains organismes se déplacent verticalement dans la zone photique en réponse à la lumière, que ce soit pour se nourrir ou pour éviter d’éventuels prédateurs. Marc Sourisseau souligne que la migration du zooplancton « est la plus importante à l’échelle du globe en termes de biomasse […], [dépassant] même celle des oiseaux migrateurs terrestres », mais qu’elle risque d’être limitée à des profondeurs plus faibles dans des eaux assombries.
Il souligne que la réduction de la zone photique aura « des incidences sur la distribution verticale [des organismes zooplanctoniques]. Selon leur profondeur, cela [affectera] le type de nourriture qu’ils rencontreront dans leur couche de surface […] ainsi que les températures auxquelles ils seront exposés. Parfois, il y a des différences de température qui sont significatives sur la verticale » : on peut observer des variations de 4 degrés sur seulement 50 mètres. Pour un organisme changeant de zone, cela modifie l’ensemble de ses taux physiologiques (digestion, croissance, respiration) et peut donc affecter sa dynamique de population.
De plus, « l’augmentation de la chlorophylle ne signifie pas nécessairement une augmentation de la nourriture disponible pour les niveaux trophiques inférieurs », explique le chercheur. En effet, « plus de chlorophylle implique probablement une compétition accrue entre les organismes présents ».
Vincent Doumeizel alerte sur le fait que l’assombrissement de l’océan « va bouleverser l’équilibre des chaînes trophiques ». Etant donné que le phytoplancton constitue la base de la chaîne alimentaire pour de nombreuses espèces marines, « il est censé de dire que si l’on bouleverse le bas de la pyramide, le haut en subira des conséquences » : cela pourrait entraîner la disparition de certains poissons, avec des répercussions importantes pour la pêche.
La séquestration du carbone sera elle aussi affectée. Selon Vincent Doumeizel, « les planctons nourris par les nutriments sont finalement moins aptes à séquestrer du carbone, ce qui veut dire qu’ils ne vont pas couler mais rester en surface et donc assombrir [l’eau] ». De plus, « les planctons actuels qui dominent le climat et qui ont permis l’éclosion de la vie et de l’écosystème, ont des carapaces qui leur permettent de couler. […] Le réchauffement et l’assombrissement des océans empêchent [cependant] les planctons [capables] de développer une carapace de proliférer ».
Par conséquent, « l’océan, qui absorbe actuellement 30 % des émissions de CO₂, pourrait cesser de le faire, voire finir par en rejeter ». Pour le spécialiste, la revégétalisation des côtes serait une solution pour rétablir l’équilibre océanique, car « elle apporterait des nutriments sains, favorisant le développement de types de planctons plus transparents et qui séquestrent davantage de carbone ».