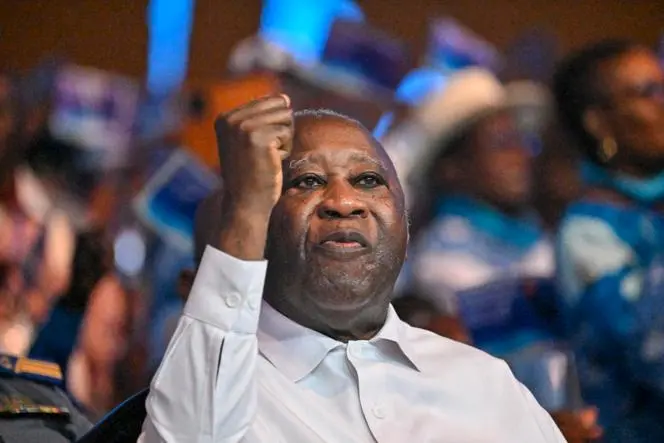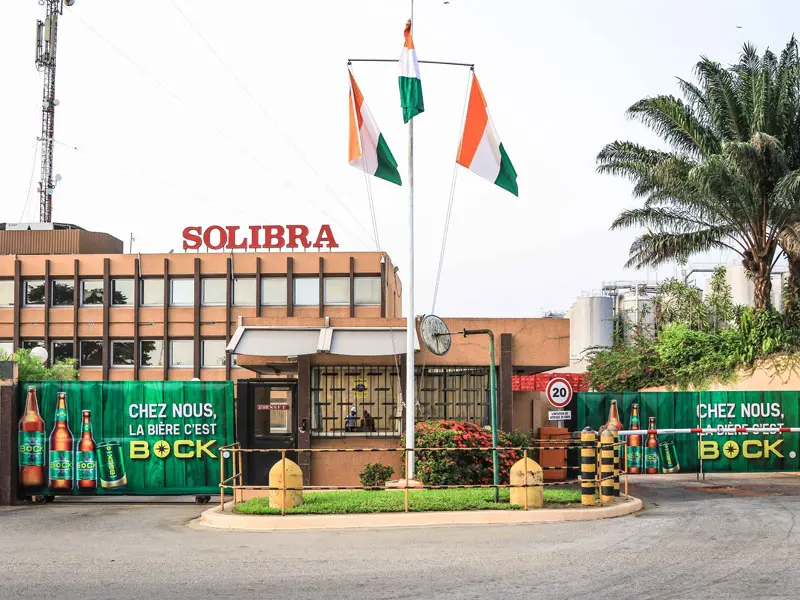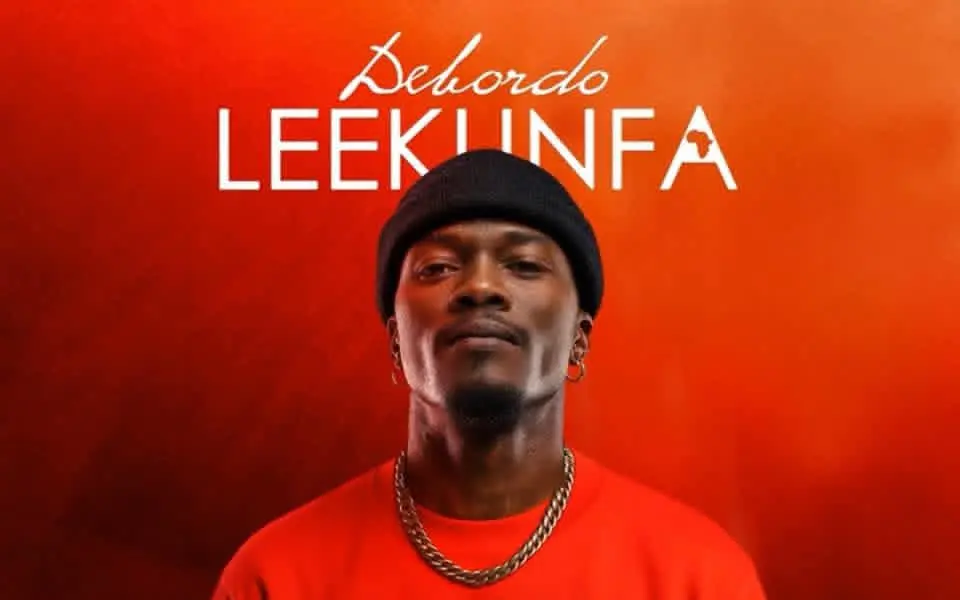Les manchots les plus rares du monde ne craignent pas la chaleur

À près de 950 kilomètres de la côte équatorienne, la biologiste de la conservation Dee Boersma vogue sur les eaux bleues qui entourent l’île Bartolomé à bord d’un Zodiac pneumatique. Les îles des Galápagos se trouvent dans cette petite partie de l’océan Pacifique. Dee Boersma n’est pas seule, elle est accompagnée de plusieurs autres scientifiques et tous scannent les plages à la recherche d’un oiseau marin noir et blanc, difficilement observable. Mesurant près de 50 centimètres, les manchots des Galápagos font partie des manchots les plus rares et les plus petits du monde. Mais surtout, ils sont les seuls à vivre au niveau de l’équateur, sur ces îles volcaniques qui rôtissent au soleil.
« Comment ne pas tomber amoureux de ces oiseaux ? » demande Dee Boersma. À soixante-dix-huit ans, cette exploratrice National Geographic est la directrice du centre des sentinelles de l’écosystème de l’université de Washington. « Ils sont drôles, ils sont curieux, ils sont attachants. »
Soudain, elle pointe du doigt cinq pingouins qui se trouvent à l’entrée d’une grotte. Puis un autre, et encore un autre. Ils sont sept au total. Une fois que le bateau s’est suffisamment approché pour accoster, deux Équatoriens, le vétérinaire M. Gavilanes Escobar et le garde du parc Marlon Ramón, sautent du bateau, escaladant adroitement les rochers pointus et glissants. En moins de cinq minutes, Gavilanes Escobar est de retour, transportant prudemment avec lui un manchot, une main sous son menton et l’autre sous ses pattes. Il le tend à Dee Boersma, armée de son pied à coulisse, prête à mesurer la taille de son bec et de des pieds. Puis elle sort un mètre ruban pour vérifier son envergure. « On prend ses mesures pour lui faire un costume », plaisante-t-elle.
Ce sont les premières étapes de la prise d’informations qui aideront les chercheurs à s’assurer de la bonne santé de la colonie se trouvant dans cette zone. Ensuite, Dee Boersma sangle un cordon rouge autour du torse du manchot et l’attache à une balance. Sans voler, l’oiseau se retrouve alors dans les airs, les pattes trépignantes. « C'est un gros [spécimen] », confie Dee Boersma à sa collègue, Caroline Cappello, une écologiste de la vie sauvage qui étudie les manchots des Galápagos aux côtés de Dee Boersma depuis plus de dix ans. Caroline Cappello note les données ainsi observées. Un peu plus de 2,2 kilogrammes et probablement un mâle. Délivrant le manchot impatient de sa sangle, Dee Boersma coince ensuite sa tête entre son avant-bras gauche et son genou, en un geste qui fait montre de son expérience, pour protéger ses jambes de morsures douloureuses. « Tout va bien, tout va bien », rassure-t-elle le manchot gigotant. « Tu es tout doux. Si, je t’assure. Calme-toi. Encore une minute et on te laisse tranquille. »
Les pieds palmés des manchots sont épais sur le dessus et effilés au bout, la forme idéale pour fendre les eaux. Sur cet individu, Dee Boersma remarque qu’ils sont en bonnes conditions, les lissant de ses mains protégées par des mitaines en laine beige. Elle fixe une petite étiquette en métal dans la palmure du pied gauche du manchot et le dépose doucement sur le bord du Zodiac. Apparemment peu perturbé par ces manipulations, il observe l’eau avant de se pencher en avant et de se laisser tomber dans le Pacifique, rejoignant les tortues de mer vertes et les iguanes marins. « C’est exaltant de toucher un de ces oiseaux », confie la scientifique alors qu’elle le regarde disparaître sous les vagues.
C’est également une opportunité qui échappe de plus en plus aux chercheurs. Aujourd’hui, les manchots des Galápagos font partie de plus de la moitié des espèces de manchots en danger ou vulnérables. En cause, des menaces comme le réchauffement climatique, la surpêche, la destruction de leur habitat et la pollution. Dee Boersma, que l’on appelle la Jane Goodall des manchots, considère ces oiseaux comme étant des sentinelles marines, des canaris dans une mine de charbon. Elle explique que le déclin rapide d’une espèce est annonciateur d’un changement majeur, naturel ou humain, qui a lieu dans son environnement.
Elle croit toutefois que l’espèce a la capacité de s’accrocher. En partie grâce aux avancées de la recherche. Les chercheurs comprennent de mieux en mieux ces oiseaux et comment leurs siècles d’adaptation les aident à rester tenaces dans ce monde toujours plus imprévisible qui les entoure. « Il y a cinquante-quatre ans, lorsque j’ai commencé, je n’imaginais pas qu’il resterait encore des manchots des Galápagos », dit-elle. « Mais ils sont toujours là. »
Le périple évolutionnaire des manchots des Galápagos est l’exemple parfait de l’influence qu’a la pression environnementale sur la forme d’une espèce au cours du temps. Les études génétiques suggèrent qu’ils sont les descendants des manchots de Humboldt. Leur branche évolutive aurait dérivé il y a à peu près deux millions d’années durant la période du Pléistocène, marquée par d’importants changements climatiques. Les premiers ancêtres des manchots des Galápagos seraient arrivés dans l’archipel en suivant le courant de Humboldt, qui apporte une eau froide et riche en nutriments au littoral d’Amérique du Sud. S’installant probablement dans la partie ouest de l’archipel, sur les îles Isabela et Fernandina, les manchots ont trouvé une abondance de nourriture et d’abris. Toujours bien présents dans les îles, les courants de Humboldt de Cromwell n’apportent à présent nutriments et pitance que par intermittence, tant en durée qu’en quantité.
L’un des facteurs significatifs, témoin de l’adaptation de l’espèce à la vie dans ce climat chaud, c’est leur lieu de nichage, installé dans les crevasses fraîches et ombragées des îles. Les côtes sont sculptées par les explosions des éruptions volcaniques et par l’érosion, fournissant les fissures et les tunnels de lave dans lesquels les manchots évitent les trop fortes chaleurs. Leur petite taille leur permet de se faufiler dans ces endroits sombres, où ils s’abritent avec leurs petits pour se cacher des prédateurs comme les serpents des Galápagos et les crabes Sally-pied-léger.
Ces oiseaux ont moins de graisse et de plumes que la plupart des autres manchots, un avantage évolutif pour la vie subtropicale. Les manchots des Galápagos, ainsi que leurs cousins, les manchots d’Humboldt, de Magellan et les manchots du Cap, appartiennent au groupe des Spheniscus, reconnaissables par les motifs noirs et blancs sur leur torse et leur tête. Tous vivent dans des climats chauds et régulent leur température corporelle en haletant, à la manière d’un chien lors d’une journée chaude. Ils se tiennent debout avec les nageoires écartées du corps pour dissiper la chaleur. Les plumes blanches sur leur crâne, ainsi que leurs chevilles et pieds dépourvus de plumage les aident également à rafraîchir leur petit corps robuste. Durant les périodes chaudes, ils sont également capables de se défaire des plumes qui se trouvent sur leur tête.
C’est cependant la flexibilité de leur période de mue (lorsqu’ils perdent leur plumage pour le remplacer) et de reproduction qui distingue les manchots des Galápagos. Ces périodes ne sont pas fixes, comme chez les autres espèces de manchots. À la place, elles sont définies par la quantité de nutriments qu’ils reçoivent des courants océaniques tièdes et des profondeurs. Ce sont les nutriments qui leur apportent l’énergie nécessaire à leur mue qui, à l’inverse des cycles des autres manchots, survient avant la reproduction et jusqu’à deux fois dans l’année. Ils sont capables de repousser leur mue et leur reproduction jusqu’à ce qu’il y ait de la nourriture en quantité suffisante ; une meilleure chance pour réussir à construire une famille.
Tout ceci signifie que leur population oscille constamment entre prospérité et déclin. Au cours des décennies et en documentant le nombre de manchots des Galápagos et leur poids, Dee Boersma a fait une découverte incroyable. Leur rythme de reproduction se synchronise avec les épisodes El Niño et La Niña. Lors des conditions La Niña, les oiseaux prospèrent, les courant forts et froids amènent des eaux riches en nutriments vers le Nord et avec elles poissons, poulpes et crustacées en abondance pour les manchots. Lorsque les eaux chaudes d’El Niño remplacent les courants froids dans le Pacifique est et centre, leur apport en nourriture se voit drastiquement réduit. Lors des années où les provisions sont rares, certains manchots meurent de faim et la reproduction stagne. Les populations peuvent prendre des dizaines d’années avant de s’en remettre. Lors d’un sévère épisode El Niño au début des années 1980, la population des manchots des Galápagos a été réduite de moitié.
À présent, avec le réchauffement climatique, les phénomènes El Niño se font plus fréquent et plus extrêmes, menaçant de réduire encore plus l’accessibilité aux nutriments alors même que la montée des eaux inonde les sites de ponte. Dee Boersma en vient toutefois à penser que même avec l’augmentation des épisodes El Niño et des événements climatiques extrêmes, certains manchots des Galápagos survivront. En effet, leur écosystème est également soutenu par les remontées périodiques des eaux abyssales, qui amènent avec elles des vagues de nutriments qui alimentent la chaîne alimentaire. « Mais si, pour une raison ou pour une autre, les courants venaient à changer et la productivité diminuait, les manchots rencontreraient des problèmes. Ils n’auraient nulle part où aller, si ce n’est le Pérou ou le Chili, et, à la nage, ce n’est pas la porte à côté », s'inquiète Dee Boersma.
Selon les estimations de la scientifique, il resterait encore deux mille manchots des Galápagos, deux fois moins qu’il y a cinquante ans, au début de ses recherches d’avant-garde. Dee Boersma est toutefois persuadée que certaines actions cruciales pourraient leur assurer un avenir moins sombre.
Pour survivre et prospérer, les manchots auront besoin de l’aide des humains pour faire face à deux menaces majeures : les prédateurs introduits dans leur habitat, les rats et les chats surtout, et l’inhospitalité croissante de leurs lieux de ponte naturels.
Il est assez simple de résoudre ce premier problème. Les chats et les rats sont arrivés dans les Galápagos il y a environ deux cents ans, avec les navires marins et les chasseurs de baleines. Ils parviennent aisément à escalader le terrain difficile et à pénétrer dans les nids de manchots et d’autres oiseaux marins, dévorant œufs et petits. Le Parc national des Galápagos a récemment fait équipe avec l’organisation environnementale Jocotoco dans le cadre d’un programme d’éradication des espèces invasives sur l’île Floreana dans la partie sud de l’archipel. En octobre 2023, les responsables du parc ont commencé le processus d’extermination des rats et des chats sur Floreana en utilisant des pièges et des hélicoptères autonomes ultralégers pour disperser des palets de rodenticide ainsi que des saucisses empoisonnées à travers l’île. Ce programme a l’air d’être efficace. Un petit nombre de manchots demeuraient encore « difficilement » sur l’île, raconte Dee Boersma. Retirer les prédateurs de l’équation et continuer à observer leur présence donnera aux oiseaux « une bonne chance de survie sur le long terme ».
Pour contrer la seconde menace, Dee Boersma et ses collègues espèrent débloquer des fonds afin de construire des nids artificiels et aider les oiseaux à recoloniser Floreana. Cette idée a germé pour la première fois dans l’esprit de la scientifique il y a quelques années, quand un couple de manchots a attiré son attention. Ils nichaient au-dessus de la lave à l’ouest de l’archipel sur l’île Fernandina, sans aucune ombre. Les oiseaux se relayaient pour couver les œufs, du début de soirée jusqu’au matin, mais disparaissaient dans la journée, laissant les œufs exposés au soleil. Ils n’ont jamais éclos et ont fini par mourir. Dee Boersma s’est rendu compte qu’il n’y avait pas suffisamment de nids à l’ombre et que cela pouvait limiter le nombre de nouveaux petits s’ajoutant à la population chaque année.
Elle a commencé à expérimenter avec des nids artificiels il y a quinze ans, testant différents modèles pour qu’ils se fondent dans l’environnement et n’entachent pas la beauté naturelle des îles. « Le parc ne voulait pas de sortes de niches pour chiens ou ce que l’on utilise dans les zoos », explique-t-elle. L’une des options consistait en un petit abri fait de roches volcaniques empilées. L’autre, celle que les manchots en sont venus à préférer, était de creuser des trous directement dans les substrats de lave durcie. Comme pour tout logement, la localisation était primordiale. Les nids devaient être proches de l’eau, mais suffisamment éloignés pour qu’ils ne se retrouvent pas inondés durant les trois mois de couve des manchots. « L’idée de construire des nids, c’est que, lorsque les conditions sont réunies, tous les individus voulant se reproduire puissent se reproduire », explique Dee Boersma.
Au troisième jour de leur expédition, la scientifique et son équipe arrivent à Punta Espinoza, sur l’île Fernandina, là où Dee Boersma a pour la première fois mis ses nids artificiels à l’usage. L’équipe désembarque du Zodiac et traverse prudemment le paysage de lave, abrupt et parsemé de déjections d’iguanes. Deux membres du groupe ont vérifié les différents nids à travers l’île : Caroline Cappelle, trente-cinq ans, qui continue ses recherches postdoctorales à l’université de Cornell, et Aura Banda Cruz, quarante-deux ans, résidente de troisième génération des Galápagos et naturaliste travaillant à bord du bateau de croisière, le Silversea, l’hôte de Dee Boersma et son équipe, ainsi que d’une nuée de touristes.
En vérifiant un petit espace entre deux rochers, Caroline Cappello crie avoir trouvé un nid artificiel apparemment récemment utilisé. Elle y voit des éclats de coquille d’œufs et des plumes se trouvent autour de la zone. « L’œuf a peut-être éclos, ou bien il a été dévoré », observe-t-elle en glissant les coquilles dans une enveloppe pour les étudier plus tard. Quoi qu’il en soit, tout signe d’activité dans ces nids est bon à prendre.
Au cours de sa carrière en tant que naturaliste à bord d’un bateau de croisière, Aura Banda Cruz a passé près d’une dizaine d’années à photographier des manchots des Galápagos. Cette expérience lui a permis de développer une méthode non-invasive afin d’identifier les individus : elle repère les motifs distinctifs des points qui se trouvent sur leur torse. « Je me suis rendu compte que ces taches étaient différentes sur chacun d’eux », explique-t-elle. « Elles sont uniques, un peu comme des empreintes digitales. » Les chercheurs distinguent les jaguars, zèbres, dauphins et même les koalas d’une façon similaire, en étudiant les motifs qui parcourent leur corps.
Aura Banda Cruz a bon espoir que, le temps passant et entre les périodes annuelles d’études des populations, elle pourra s’associer avec d’autres photographes naturalistes afin de créer une archive visuelle pouvant être utilisée pour identifier les manchots. De manière générale, les images seront aussi un moyen de s’assurer de la bonne santé des individus, ainsi que de la proportion de juvéniles et d’adultes. « Les adultes sont reconnaissables grâce à la ligne blanche qu’ils ont autour des joues, et leurs pieds noirs », mentionne Aura Banda Cruz. « Les juvéniles, eux, ont les pieds plus pâles et les joues blanches. »
De plus, les photos pourront aider à documenter les périodes durant lesquelles les manchots ont plus de mal à trouver leur nourriture, le plus souvent durant un épisode El Niño. « Ils commencent à passer plus de temps dans l’eau », explique la naturaliste. « Ils n’ont pas le temps de sécher complètement et se retrouvent couverts d’algues vertes. Quand on voit un manchot tout vert, c’est un signe que les choses ne vont pas bien pour eux. »
Pour sa part, Dee Boersma est exaltée à l’idée de continuer à en apprendre plus sur la vie des manchots des Galápagos. Elle pense surtout à la prochaine génération de scientifiques. Pendant longtemps, elle craignait de ne pas trouver de successeurs qui reprendraient ses recherches sur les manchots des Galápagos à sa retraite. « On se rend vite compte que nos jours sont comptés lorsque l’on crapahute sur la lave, on ne peut pas faire ça toute sa vie », dit-elle, assise au bord du Zodiac tandis que ses collègues vérifient une autre zone de vie des manchots et les signes de nids. « C’est pour cela que j’étais heureuse de rencontrer Caroline, et maintenant Aura. Je pense qu’elles forment une équipe dynamique et qu’elles pourraient le rester pendant dix, vingt, trente ans si elles le souhaitent. »
Elle observe en silence un manchot mâle, qui se tient seul debout sur une plage, profitant de la lumière dorée de la fin d’après-midi. Il jabote, essayant d’attirer une compagne. Dee Boersma l’imite pour lui répondre. « Là, il dit “Viens voir mes marques, j’ai un bon nid, viens jeter un œil” », sourit-elle.
Si les conditions restent aussi favorables qu’elles l’ont été ces dernières semaines, une eau fraiche et une abondance de poissons, elle est confiante : « il se reproduira bientôt ».