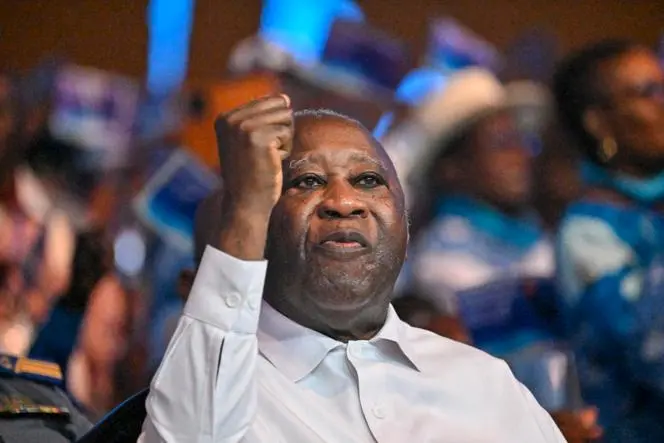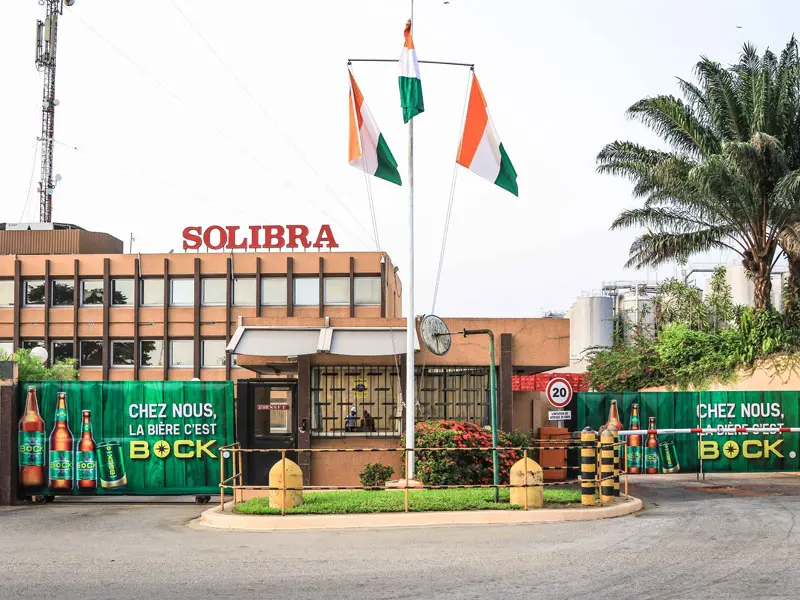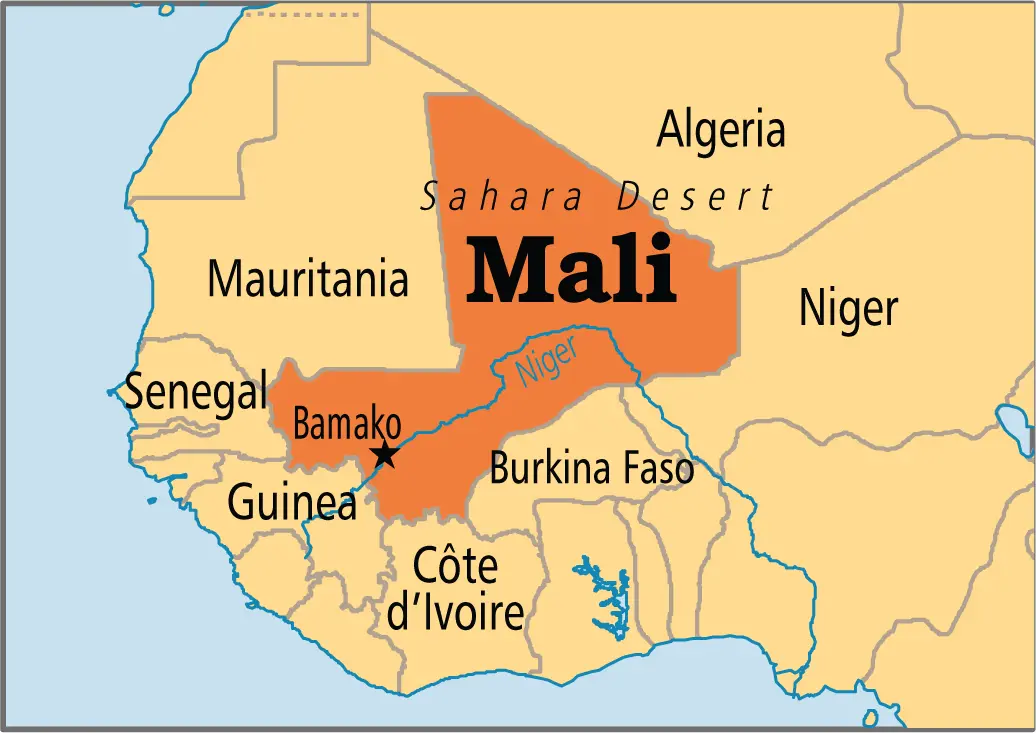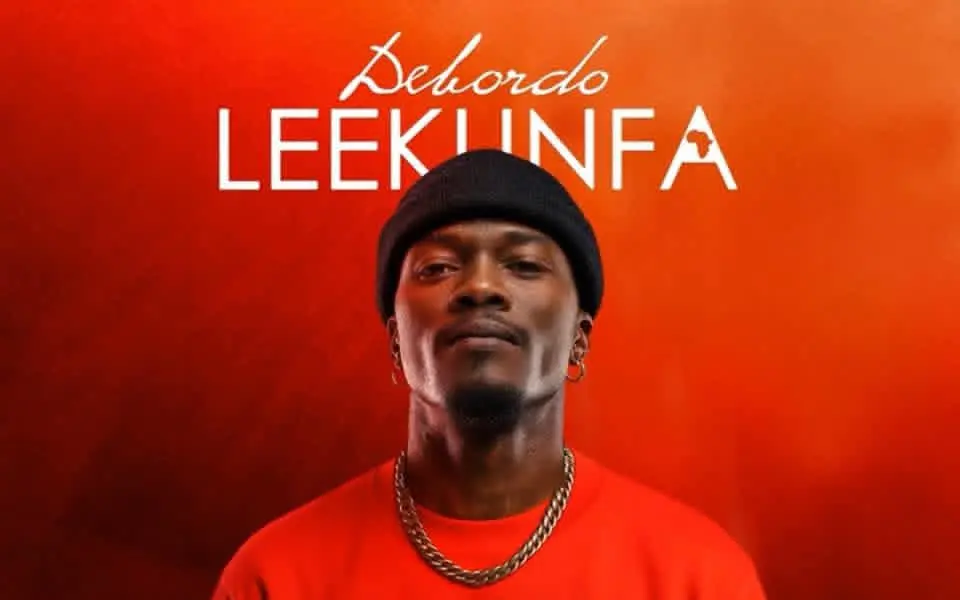Fidji : la découverte d’une fosse commune relance les théories de cannibalisme

Le rivage bordé de récifs de la plus grande île des Fidji, Viti Levu, attire des touristes impatients de pratiquer la plongée dans ses eaux tropicales. Mais à quelques kilomètres de là, dans les terres, des villageois ont découvert une fosse commune qui pourrait jeter une lumière nouvelle sur une période agitée et sinistre de l’histoire de l’archipel du Pacifique Sud.
Les restes humains ont été mis au jour le 29 février 2024, au sommet d’une colline fortifiée surplombant la rivière vaseuse de Sigatoka, qui serpente à travers les hautes terres sauvages de Viti Levu. Ils doivent être analysés, mais ils appartiendraient, selon les locaux, aux victimes d’un cannibalisme rituel pratiqué depuis longtemps en temps de guerre tribale. Les archéologues penchent plutôt pour une épidémie de rougeole particulièrement violente, survenue à la suite d’une visite du roi des Fidji en Australie en 1875, qui a résulté en la mort d’un tiers de ses sujets.
Les Fidji comptent plus de 300 îles volcaniques et se situent à environ 2 000 kilomètres au nord de la Nouvelle-Zélande. Le peuple marin des Lapita, à savoir les ancêtres des Polynésiens d’aujourd’hui, s’y est installé il y a 3 000 ans. Les colons sont par la suite arrivés des îles mélanésiennes à l’ouest, mais aussi des avant-postes polynésiens à l’est comme les îles Samoa et les îles Tonga. L’archipel est ensuite devenu, au siècle dernier, un important carrefour commercial du Pacifique Sud.
GUERRE ET ÉPIDÉMIE
En 1789, le capitaine William Bligh, à bord du Bounty, devint le premier européen à longer la côte fidjienne. Il sera suivi par des marchands et missionnaires américains et européens au début et au milieu du 19e siècle. Ceux-ci surnommèrent la région « les îles des Cannibales » et cherchèrent à mettre fin au cannibalisme rituel, qui consiste, en temps de guerre, à ce que les vainqueurs consomment les vaincus pour obtenir le pouvoir de leurs victimes. Les chrétiens occidentaux exploitèrent également les concombres de mer de la région pour les exporter en Chine et les planteurs britanniques et américains débarquèrent rapidement à la recherche de terre où cultiver du coton. Ce bouleversement religieux et économique conduisit à une augmentation des conflits entre les différents clans et tribus des Fidji alors que la Grande-Bretagne et les États-Unis cherchaient à annexer l’archipel fertile.
La crise parvint à un point critique en 1867, lorsque le missionnaire britannique Thomas Baker essaya de convertir au christianisme les membres d’une tribu des hautes terres le long de la rivière Sigatoka. Il aurait rendu furieux les locaux en touchant la tête de leur chef, ce qui constituait un grave tabou culturel. Le missionnaire et sept de ses convertis fidjiens furent alors démembrés, brûlés et mangés par les villageois de Viti Levu. (Les sandales en cuir de Thomas Baker sont d’ailleurs exposées au musée des Fidji, situé à Suva, la capitale de l’archipel.) La mort du missionnaire, les attaques des autochtones et le massacre ultérieur de deux colons blancs poussèrent les justiciers blancs (dont un groupe qui s’est donné le nom de Ku Klux Klan, d’après l’organisation de suprémacistes blancs américains) à sillonner les îles pour se venger.
Le chaos déboucha finalement sur une guerre opposant les Fidjiens des hautes terres restés fidèles à leurs traditions à la Grande-Bretagne et ses alliés fidjiens et chrétiens blancs de la côte. Une faction traditionaliste était basée à Tavuni, stratégiquement haut perchée au-dessus d’un coude de la rivière Sigatoka, à une dizaine de kilomètres dans les terres de Viti Levu. Les fouilles archéologiques et les histoires orales montrent qu’un immigré tongien qui s’était installé à Tavuni vers 1800 y a construit une habitation pour un chef et quelque soixante autres bâtiments sur la haute crête, et a épousé plusieurs femmes locales.
Au début des années 1870, les villageois de la région se rallièrent à la tribu Kai Colo des hautes terres dans une guerre de guérilla les opposant au premier gouvernement unifié des Fidji, dirigé par le monarque chrétien Cakobau. En 1874, le roi confia le contrôle des Fidji à l’Empire britannique, avant de se rendre à Sydney par bateau pour célébrer l’annexion. C’est là-bas que lui et son équipe diplomatique contractèrent la rougeole. À leur retour, le virus se propagea rapidement dans une population à l’immunité fragile. Quelque 40 000 Fidjiens autochtones succombèrent à cette terrible épidémie. Dans le même temps, les soldats britanniques et les forces de Cakobau lancèrent une campagne brutale pour vaincre les Kai Colo et leurs alliés. Lors d’une bataille en 1876, Tavuni fut brûlé et les rebelles s’évanouirent dans les hautes terres. Laissée à l’abandon, la formidable redoute fut rapidement engloutie par la forêt.
UNE DÉCOUVERTE ACCIDENTELLE
« C’était la jungle », confie Lanieta Laulau, qui a grandi dans un village proche de Tavuni. « Nous avions l’habitude d’y monter pour ramasser du bois, mais nous ignorions tout de son passé ». Dans les années 1980, des locaux ont défriché la zone et les archéologues ont mis au jour les fondations de dizaines de maisons ainsi que des murets de protection encerclant les pentes raides pour les rendre accessibles aux touristes. Lanieta a participé au défrichement et travaille désormais comme gardienne du monument historique national, qu’une tribu locale loue au gouvernement.
En février 2024, lorsque le chef de la tribu locale est mort, les villageois ont décidé de l’enterrer sur le point culminant de Tavuni. C’est en creusant la tombe qu’ils sont tombés sur de nombreux ossements humains. « Il y avait des tas et des tas d’os », raconte Lanieta Laulau. « Ce n’était pas la tombe d’une seule personne. Il y avait plusieurs corps », ajoute-t-elle.
Elle qui s’était opposée à la décision des villageois de creuser une tombe sur un site historique est parvenue à garder des dizaines d’ossements pour les faire analyser. Le reste a été enseveli à nouveau. Au cours d’une visite au mois de mars, munie d’un sac plastique transparent trouvé dans son bureau au centre d’accueil des visiteurs, elle y a délicatement déposés les os récupérés sur une table de pique-nique, à l’extérieur. Il y avait des calottes, des mâchoires avec des dents, ainsi que plusieurs os des bras et des jambes.
Selon Elia Nakoro, archéologue en chef au Musée des Fidji, seules deux fosses communes de ce type ont été mises au jour dans l’archipel, bien que les ossements aient été enterrés à nouveau sans être analysés. Toutes deux se trouvaient dans les environs de collines fortifiées. Il ajoute que certaines parties des squelettes ont été découvertes hors des tombes traditionnelles, ce qui laisse penser qu’elles ont été disposées ainsi pour effrayer les intrus.
Étant donné que Tavuni n’a été occupée que par des Fidjiens traditionnels, Lanieta Laulau estime que les morts étaient sans doute des guerriers vaincus qui furent mangés par ceux tués par les défendeurs de la forteresse. « Ils ont mangé la chair et laissé les os, qu’ils ont enterrés au même endroit », souligne-t-elle en pointant du doigt une pierre monolithique présente sur le site qui était, selon la tradition locale, le lieu d’exécution rituelle des prisonniers. Les preuves archéologiques obtenues à partir des ossements des humains massacrés sur le chapelet d’îles suggèrent que la pratique, ancienne, avait uniquement lieu dans des conditions rituelles précises.
Elia Nakoro pense plutôt que ces ossements appartiennent à des personnes ayant péri lors de l’épidémie de rougeole de 1875, soit avant que le fort ne soit brûlé. Patrick Nunn, archéologue à l’Université de la Sunshine Coast en Australie, partage son avis. « Il s’agit fort probablement d’une fosse commune du 19e siècle, époque à laquelle la rougeole et la grippe ont décimé les populations fidjiennes, qui n’avaient aucune résistance naturelle à ces maladies », explique-t-il. Les enfants étaient particulièrement vulnérables. Ces infections virales sont apparues il y a plus de 5 000 ans chez des bovins en Mésopotamie, se propageant dans le Pacifique Sud avec l’arrivée des Européens. Les habitants de la région sont morts en si grands nombres que les survivants, affaiblis, auraient eu du mal à les enterrer.
Elia Nakoro compte envoyer les ossements au laboratoire de Patrick Nunn pour les faire analyser. Ceci devrait permettre d’obtenir des données importantes sur l’âge, le sexe et la cause du décès des victimes, et de livrer des indices sur le moment de leur mort. En cas de cannibalisme, les chercheurs trouveront des marques sur les os ; si c’est une maladie qui est responsable de leur décès, un examen moléculaire des ossements permettra de l’identifier.
En attendant, Lanieta Laulau surveille de très près cette trouvaille précieuse ; elle dort même au centre d’accueil des visiteurs pour protéger les os de tout dommage ou vol. Son mari, en revanche, refuse de se joindre à elle à sa veille. « Il m’a dit “Hors de question de dormir ici. Ce sont tes ancêtres. Je viens d’une autre province, ils pourraient m’attaquer!” », raconte-t-elle avec un sourire.