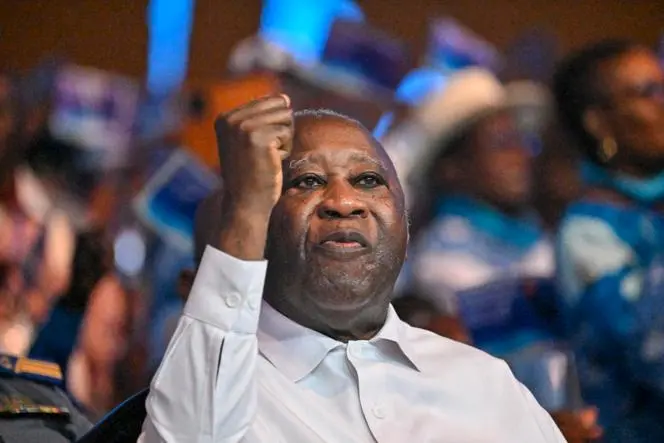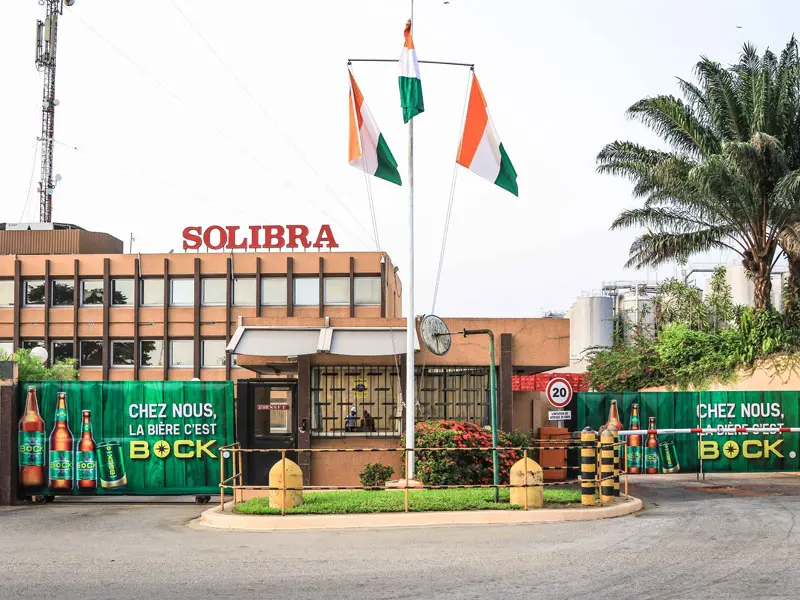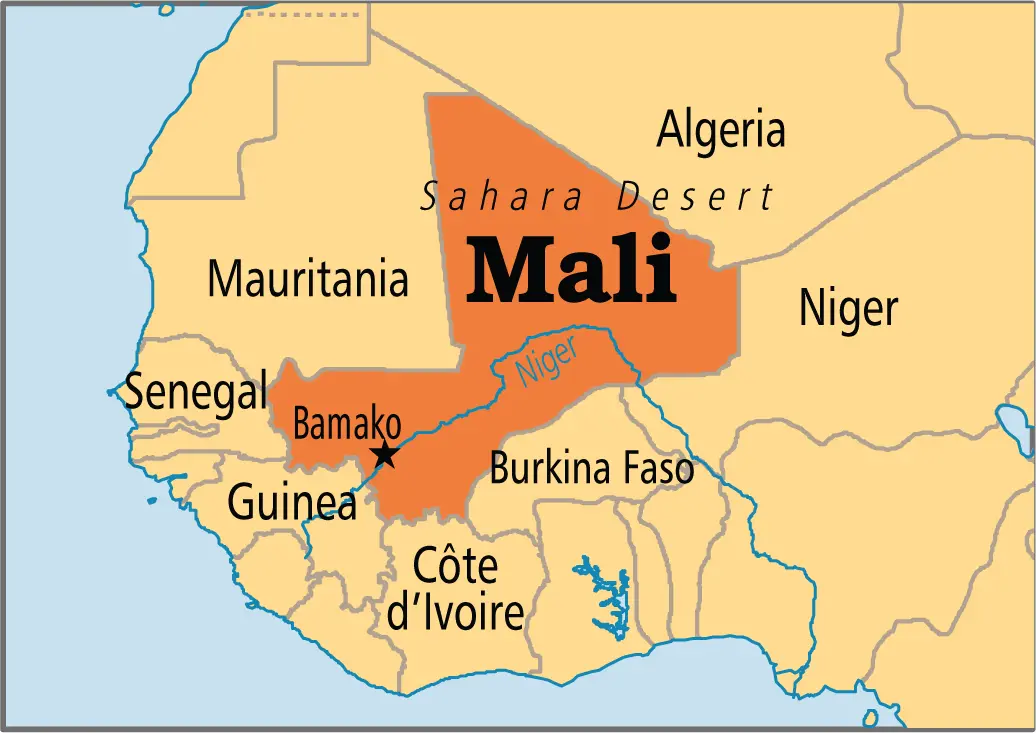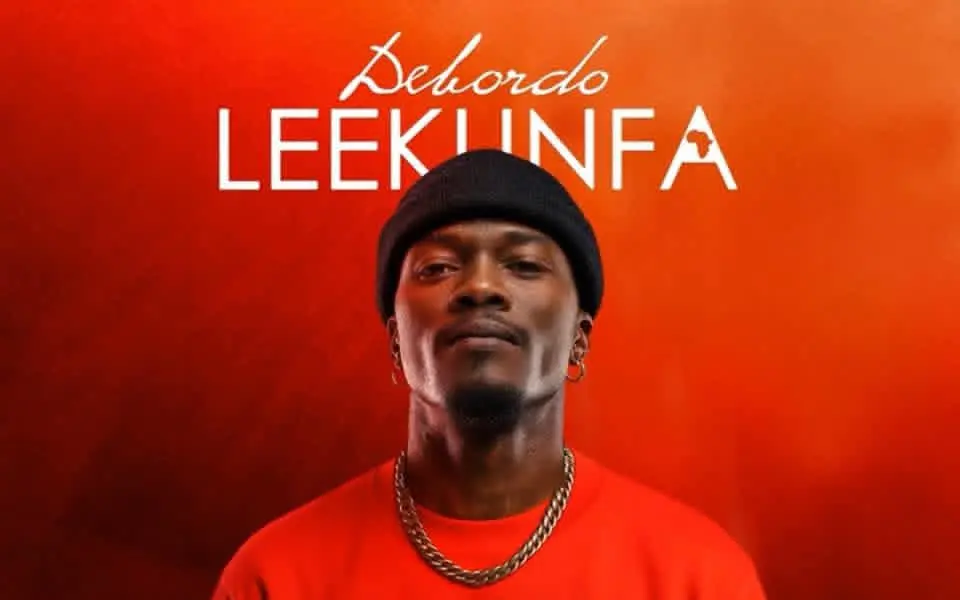La course contre la montre pour sauver les vestiges historiques de l’Arctique

Le long des côtes rocheuses de la baie Pasley, un littoral inhabité de l’Arctique canadien, l’archéologue Aka Simonsen marche à grandes enjambées, au rythme des marées, les yeux rivés sur le sol. Le temps presse.
Le brouillard s’épaissit, assourdissant la lumière du matin ; si celui-ci venait à se faire trop dense, il obscurcirait dangereusement la vue des membres de l’expédition armée guettant la présence d’ours polaires (Ursus maritimus) et forcerait l’archéologue à retourner au navire ancré dans la baie.
Aka Simonsen, une inuite du Groenland qui gère le site de Kujataa, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture), dans le sud du Groenland, est l’une des rares archéologues spécialisées dans l’étude de la région arctique. Non loin d’elle, la Canadienne Kaylee Baxter passe le sol au peigne fin. Lorsque je les ai rencontrées en septembre, toutes deux participaient en tant qu’expertes à une expédition organisée par le voyagiste Adventure Canada, un moyen stratégique pour deux archéologues indépendantes disposant de fonds limités d’accéder à certains des sites les plus reculés de la planète.
Le matin du 9 septembre, le duo s’est hâté sur ce rivage afin de découvrir si celui-ci recelait de sites archéologiques n’ayant pas encore été répertoriés. Ces vestiges aideront Aka Simonsen, Kaylee Baxter et d’autres spécialistes à reconstituer la vie dans cette région jusqu’à cinq mille ans en arrière : quel type de gibier était chassé et de quelle façon, de quelle manière les sociétés se sont-elles formées et qu’est-ce qui leur a permis de survivre dans une région aussi hostile.
Si ces indices ne sont pas trouvés sous peu, ils pourraient être perdus à jamais.
L’Arctique se réchauffe rapidement en raison du changement climatique, qui emporte avec lui des reliques du passé. Or, le monde moderne a besoin de ces traces laissées par les premiers peuples de l’Arctique. Que pouvons-nous apprendre de leurs migrations, de leurs changements culturels et des outils leur ayant permis de survivre durant les périodes d’instabilité climatique afin de faire face au changement climatique moderne ?
LES PREMIÈRES POPULATIONS AYANT HABITÉ L’ARCTIQUE
Les régions les plus septentrionales de la Terre recèlent de nombreux vestiges de l’histoire de l’humanité. Les peuples qui y vivaient étaient étroitement liés à la terre et à ses ressources.
Ce paysage est glacial, sombre et recouvert de glace durant une grande partie de l’année. En septembre, néanmoins, il s’anime de manière surprenante d’une flore aux tons de rouille et de vert, ainsi que de ruisseaux qui courent sur la roche nue. Le littoral est parsemé de traces d’ours polaires, de renards et d’oiseaux. Le vent qui souffle depuis l’océan ou les glaciers de marée peut être mordant mais le soleil, même bas dans le ciel de fin d’été, apporte de la chaleur.
Grâce au froid de la glace et du pergélisol, les objets anciens sont souvent figés dans le temps ; Kaylee Baxter a un jour trouvé une touffe de poils d’animal tressée, vieille de plusieurs siècles, qui semblait avoir été laissée la veille même.
L’Arctique est toutefois une région isolée, difficile d’accès sur le plan logistique, qui constitue le domaine des ours polaires, les plus grands carnivores terrestres du monde. C’est un environnement aux températures et à la luminosité extrêmes. Seuls quelques mois d’été y sont propices au travail sur le terrain. Par conséquent, Kaylee Baxter et Aka Simonsen estiment qu’il existe probablement des milliers de sites et de vestiges archéologiques que les scientifiques n’ont pas encore découverts.
Les archéologues savent cependant que plusieurs cultures distinctes se sont succédées dans cette région. Les premières à avoir été présentes sur les terres du Canada et du Groenland actuels, un sous-groupe de peuples arctiques différents de ceux qui habitaient la Russie et le nord de la Scandinavie, sont appelées « Paléo-Inuites ». Elles ont en grande partie fait place à la culture de Thulé, ancêtre des Inuits et des Yupiks d’aujourd’hui, il y a près de mille ans. Si ce que ces cultures pêchaient et chassaient était varié, allant de la baleine au phoque, en passant par le caribou, jusqu’à l’ours polaire, celles-ci étaient toutes nomades et se déplaçaient selon les saisons, s’installant à divers endroits l’hiver et l’été, cueillant des plantes arctiques et construisant des maisons à partir de glace, de pierre et de peaux d’animaux.
LE RÉCHAUFFEMENT RAPIDE DE L’ARCTIQUE
Ces recherches déjà laborieuses deviennent de plus en plus ardues. L’Arctique se réchauffe jusqu’à quatre fois plus vite que le reste du monde.
Les conditions météorologiques extrêmes, des vagues de chaleur tardives aux violentes tempêtes de neige, suivies d’une fonte des neiges précoce au printemps, endommagent les sites fragiles. L’érosion côtière engloutit des villages entiers le long du littoral.
Bjarne Grønnow, enseignant-chercheur en archéologie arctique au Musée national du Danemark, indique avoir vu au cours de la dernière décennie, au nord-est du Groenland, disparaître dans la mer, sur 9 mètres de long, une installation de Thulé. La multiplication des tempêtes et la diminution de la glace flottante ont permis à des vagues plus puissantes de déferler sur le rivage et d’emporter les sédiments meubles.
Le sol autrefois gelé en permanence est en train de dégeler, exposant tout à coup des matériaux organiques intacts, comme des vêtements en fourrure et en peau, des cheveux, du cuir, voire des restes humains et animaux, à l’oxygène qui les décompose rapidement. Aka Simonsen explique que les tombes qui renfermaient des kayaks, enterrés avec les chasseurs, ne contiennent plus que la silhouette des embarcations ; et les momies découvertes voici quelques décennies et laissées intactes ne sont plus que des squelettes, leurs tissus et leur peau gelés ayant été exposés à un air plus chaud.
Bjarne Grønnow qualifie les efforts actuellement fournis dans le but de trouver et mettre au jour les vestiges de l’Arctique d’« archéologie de sauvetage ». « Mais c’est impossible de sauver toutes les informations contenues au sein des sites qui s’érodent ou dégèlent », confie-t-il.
Lors de mes échanges avec des archéologues, plusieurs ont comparé le rythme de dégradation dans l’Arctique à l’incendie de la bibliothèque d’Alexandrie, où tout, des outils aux vêtements, en passant par les traces d’interactions interculturelles, est en proie aux dommages causés par le changement climatique.
COMMENT LES POPULATIONS SE SONT-ELLES ADAPTÉES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ?
Les vestiges archéologiques découverts dans l’est du Canada et dans l’Arctique groenlandais couvrent un peu moins de 5 000 ans d’histoire et d’occupation humaines.
Dans ce laps de temps se sont succédées différentes tendances en termes de réchauffement et de refroidissement, notamment les fluctuations importantes de l’optimum climatique médiéval, qui a duré de 900 à 1300, suivi du petit âge glaciaire.
Selon Kaylee Baxter et Aka Simonsen, les populations arctiques se sont rapidement adaptées à ces changements climatiques spectaculaires en modifiant leur façon de bâtir leurs logis, de concevoir leurs armes de chasse et de voyager.
Les premiers peuples de Dorset, par exemple, construisaient des habitations avec des foyers placés en-dehors de la pièce principale ; lorsque le climat s’est refroidi quelques siècles plus tard, les foyers ont fait leur apparition au milieu de celle-ci afin de fournir de la chaleur. Par la suite, lorsque le climat est devenu encore plus froid, les sites d’habitations se sont raréfiés sur la terre ferme, ce qui suggère que ces dernières étaient construites sur la banquise à partir de neige, permettant peut-être de chasser plus aisément les créatures marines.
L’une des énigmes de l’histoire de l’Arctique reste la disparition mystérieuse, il y a entre cinq et sept cents ans, des derniers peuples de Dorset, qui vivaient sur les terres des actuels Canada et Groenland. D’après Kaylee Baxter, quelques théories expliquant le déclin si rapide de cette culture portent sur le changement climatique : « peut-être n’ont-ils pas réussi à s’adapter ou bien n’ont-ils pas été capables de le faire rapidement ».
D’aucuns pensent que les derniers Dorsétiens, qui dépendaient des trous dans la banquise pour la chasse, notamment des phoques et des narvals, ne se sont pas acclimatés dans ce domaine, en se servant de bateaux ou bien d’arcs et de flèches pour chasser des mammifères terrestres, lorsque l’optimum climatique médiéval a entraîné un recul de la banquise.
Pendant ce temps, la culture de Thulé s’est développée et a prospéré. Elle a inventé le kayak, un bateau de chasse construit avec des os de baleine et de la peau de phoque, conçu pour glisser silencieusement sur l’eau, avec différents modèles adaptés aux diverses conditions maritimes. Elle est également à l’origine du norsaq, un levier qui permettait de lancer un harpon depuis la pointe d’un kayak avec suffisamment de puissance pour tuer des mammifères marins aussi gros que des morses et des baleines.
QUE PEUT NOUS APPRENDRE L’ARCHÉOLOGIE ?
Les archéologues de l’Arctique tentent toujours de répondre à une question primordiale : quelles ont été les interactions entre le climat et la culture tout au long de la préhistoire ? Les réponses nous aideront-elles à faire face au changement climatique actuel ? Kaylee Baxter et Aka Simonsen pensent que certaines leçons ont déjà été tirées.
« Au lieu d’essayer de contrôler et de modeler l’environnement pour préserver notre confort, nous [devons] changer notre façon de vivre dans cet environnement, voire de lieu de vie », explique Kaylee Baxter.
Aujourd’hui, nous semblons déterminés à plier l’environnement à notre confort : nous utilisons des climatiseurs énergivores dans des villes situées en plein désert où la chaleur est de plus en plus intense, nous construisons des digues le long des côtes érodées par la mer et nous pompons l’eau des zones urbaines inondées de manière régulière.
Aka Simonsen fait mention d’une théorie selon laquelle les Vikings auraient disparu du Groenland, non pas parce qu’ils étaient dans l’incapacité de s’adapter à l’environnement mais parce qu’ils n’en avaient pas la volonté. « Ils ne voulaient pas dénaturer leur culture et c’était un problème. Il faut être ouvert à l’adaptation. »
Alors que le monde entre dans une nouvelle ère d’instabilité climatique, notre survie dépendra de notre capacité à innover, à nous adapter et à adopter un mode de vie durable, ainsi que de notre volonté de nous inspirer des cultures qui ont réussi à surmonter d’importants changements climatiques.
À condition de trouver ces indices avant qu’il ne soit trop tard.