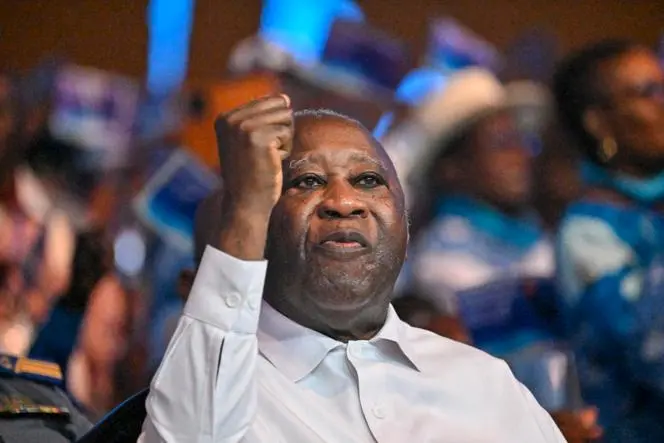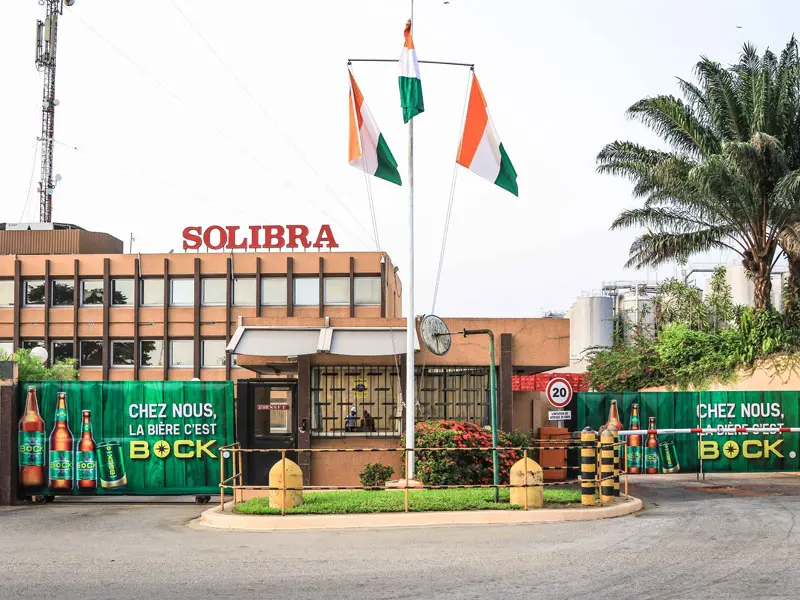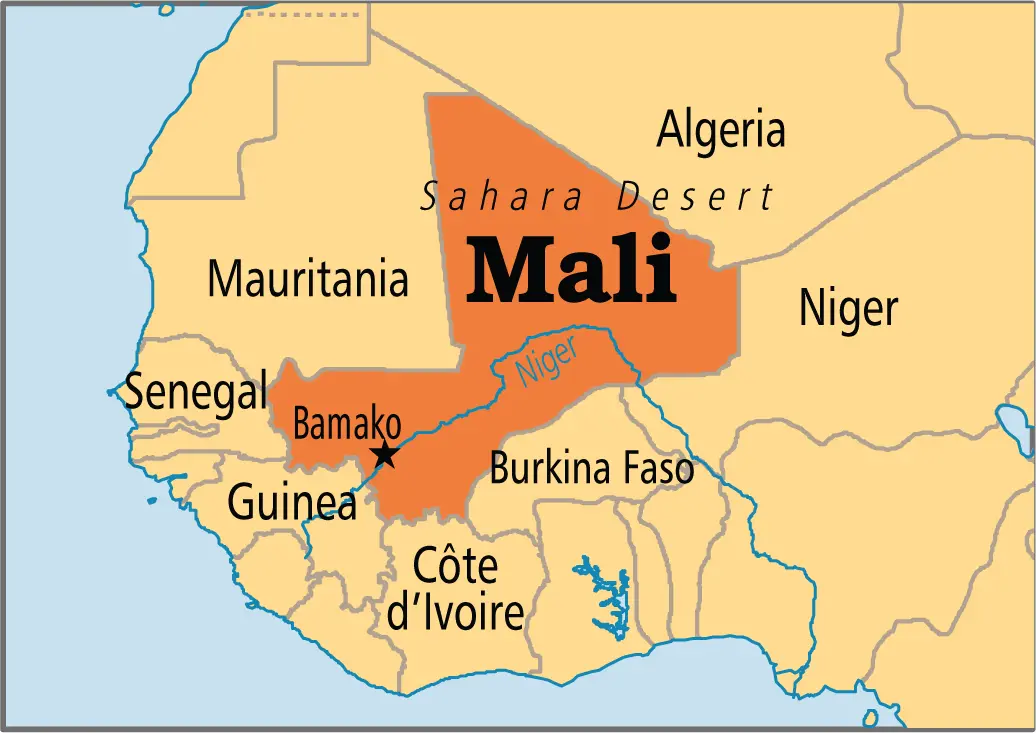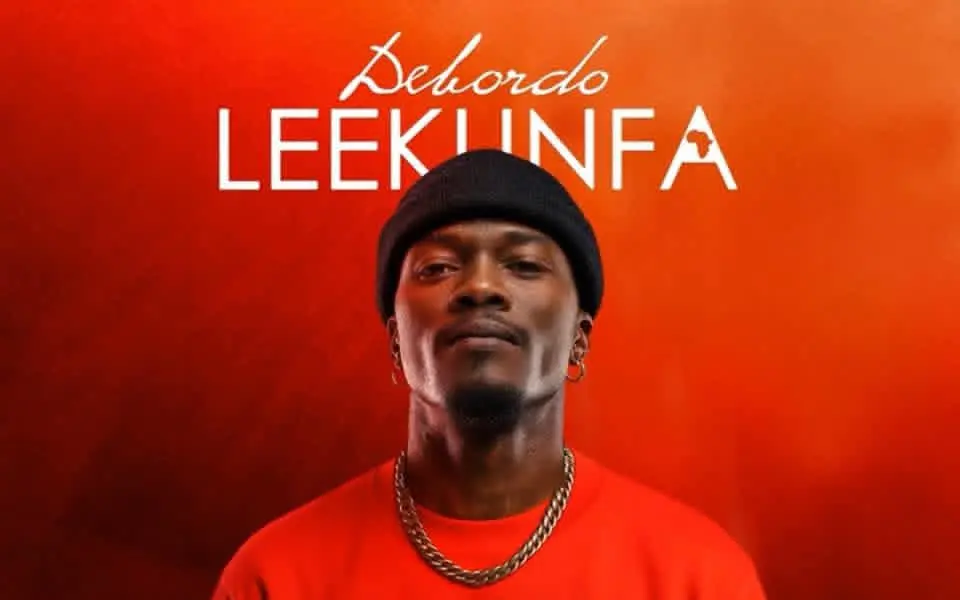Moyen Âge : des forteresses construites pour faire la guerre

L’instinct humain de chercher refuge derrière des murs ou dans des tranchées ou sur des sommets naturels ne date pas d’hier. Mais c’est au Moyen Âge, et en réaction à l’évolution des armes et de l’art de faire la guerre, que cet instinct mena à la construction de châteaux fortifiés. À cet âge d’or de leur édification, les châteaux atteignirent un degré de perfection et de complexité inédit dans l’histoire.
Les premières fortifications médiévales étaient très différentes des châteaux imposants qui apparurent par la suite. Aux neuvième et dixième siècles, les châteaux construits à travers l’Europe chrétienne étaient généralement des édifices en bois édifiés au sommet de buttes artificielles que l’on se mit à appeler « mottes » après la conquête normande. En général, une motte était entourée par des fossés défensifs ou des douves. La terre déblayée pour former ces douves servait ensuite à créer des talus défensifs surmontés d’une palissade en bois. Un pont à bascule en bois permettait de franchir la douve.
Aux 11e et 12e siècles déjà, ces mottes proliféraient à travers la France ainsi que dans l’Angleterre anglo-saxonne et normande. À mesure que progressait la Reconquista, nom donné aux guerres de reconquête que les royaumes chrétiens du nord de l’Espagne livrèrent aux royaumes musulmans qui occupaient la péninsule ibérique depuis le début du huitième siècle, on vit surgir des mottes similaires sur les plaines de Castille entre le 10e et le 11e siècle. L’une d’elles, la Mota de Muño, à Burgos, devint le centre d’une communauté active aux 10e et 11e siècles. Il n’était pas rare que des petites villes sortent de terre autour de ces châteaux, car leurs habitants profitaient de la protection offerte par les douves, remblais et palissades en bois.
Le fort en bois surmontant ces mottes furent bientôt remplacé par une grande tour en pierre généralement carrée. Cette tour centrale portait le nom de keep en anglais, de bergfried en allemand, de maschio en italien et, bien sûr, de donjon en français. Mais son nom espagnol, torre del homenaje (tour d’hommage), renvoie à l’une de ses fonctions. À partir du milieu du 10e siècle, après la chute de l’Empire carolingien, le pouvoir impérial en Europe occidentale et centrale était en train de se voir remplacé par un grand nombre de seigneurs féodaux qui étaient pratiquement souverains sur leurs territoires. Les tours d’hommage offraient des espaces où les vassaux pouvaient venir prêter allégeance à leurs seigneurs.
Les châteaux de pierre qui sont pour nous aujourd’hui emblématiques du Moyen Âge apparurent à partir des 11e et 12e siècles et dérivèrent de fortifications antérieures plus élémentaires. La nature changeante de la guerre fut le principal moteur de ce passage de simples donjons en bois à des châteaux imposants en pierre. Exceptées quelques batailles rangées, la guerre médiévale se concentrait le plus souvent sur la tentative de contrôler les forteresses d’un territoire donné. Et plus les techniques et la technologie des assaillants se sophistiquèrent, plus les bâtisseurs de châteaux redoublèrent d’ingéniosité. L’architecture des châteaux intégra alors un ensemble de murailles concentriques. En leur centre, l’ancien donjon fut agrandi pour servir d’ultime bastion défensif. Ces forteresses imposantes s’avérèrent remarquablement efficaces pour repousser attaques et invasions.
CONSTRUIRE UN CHÂTEAU
La première tâche du bâtisseur de châteaux était de choisir un emplacement adéquat. La position du château au sein du paysage par rapport aux autres enclaves fortifiées était cruciale. Il était essentiel de voir clairement les autres fortifications afin de recevoir des messages stratégiques (au moyen de feux la nuit ou de signaux de fumée le jour) qui pouvaient avertir d’un danger imminent, par exemple de l’incursion d’une armée ennemie.
Le site choisi devait dominer la zone environnante, notamment des éléments stratégiques tels que les routes, les ponts et les gués, tout en offrant un accès à des ressources agricoles et à d’autres ressources. Mais d’autres critères entraient en ligne de compte également, notamment la disponibilité de matériaux de construction et d’une réserve d’eau pour remplir puits, bassins et citernes. Les défenseurs du château devaient stocker assez de nourriture et d’eau pour leur permettre de tenir en cas de siège prolongé.
La tâche suivante était de sécuriser le périmètre extérieur. Cela impliquait de construire des défenses autour des points d’accès et des lieux stratégiques, comme les ponts et les sources d’eau. Suffisamment large, une douve empêchait l’ennemi de s’approcher des murs pour les endommager à l’aide de projectiles ou de béliers. Dans les régions au climat sec et au terrain rocheux, les douves étaient généralement sèches, étroites et profondes. Sous les latitudes tempérées et dans les régions plates au sol argileux, on creusait des douves peu profondes que l’on inondait. Dans la péninsule ibérique, le château de Calatrava la Vieja, que se disputèrent Maures et chrétiens durant tout le 12e siècle, fut construit pour transformer le Guadiana en douve naturelle sur sa partie septentrionale. Une douve creusée autour du reste du château fut remplie avec l’eau du fleuve.
Au-delà de la douve se tenaient les murs extérieurs du château. Parfois, l’on érigeait plusieurs murs autour de l’enceinte centrale, généralement disposés de manière concentrique. Cela signifiait que même si l’ennemi parvenait à percer la première ligne de défense, on pouvait encore lui tendre une embuscade avant qu’il n’atteigne le deuxième. Les murs étaient hauts, ce qui compliquait le tir de flèches et d’autres projectiles dans le château depuis l’extérieur. La hauteur servait également à décourager les grimpeurs qui tenteraient de s’y introduire la nuit à l’aide d’échelles et de prendre le château par surprise. Bien que peu évidentes, les attaques de ce type n’étaient, semble-t-il, pas rares.
À un moment donné avant la fin du 12e siècle, Ibn Sahib al-Salat, chroniqueur et historien andalou, écrivit ceci : « Lors des nuits pluvieuses et très obscures, Gérald le Sans-Peur, un aventurier portugais chrétien, préparait ses très longues échelles de bois et escaladait les murs et les tours des châteaux lui-même. » Gérald aurait, dit-on, réussi à pénétrer dans de nombreux châteaux almohades dans l’ouest de l’Espagne et au Portugal à l’aide de cette méthode.
Ce mode d’attaque était tant source de préoccupation que les Siete Partidas, corpus législatif rédigé au milieu du 13e siècle par le roi Alphonse X de Castille, stipulait que les murailles des châteaux devaient être construites suffisamment hautes pour dissuader toute tentative d’intrusion à l’aide d’une échelle.
PERSONNE N’ENTRE
Bien que le donjon occupât une place de choix en tant que principale tour fortifiée du château, les tours plus petites étaient attachées aux murs de la forteresse et les dépassaient en hauteur. De forme carrée, circulaire ou pentagonale, les tours plus petites protégeaient la base des murs et servaient de contreforts, renforçant ainsi l’ensemble de la fortification. Toute ouverture dans la muraille constituait un point faible ; les meurtrières ou les fenêtres, lorsqu’elles existaient, étaient donc étroites et placées en hauteur.
La principale entrée d’un château devait être assez grande pour permettre l’accès à l’enceinte, mais puisque toute ouverture était un point vulnérable, les bâtisseurs comme les soldats en garnison prenaient soin de renforcer les défenses de l’entrée d’un château. Les portes du château était faites de bois massif, souvent renforcées à l’aide de plaques de métal et solidement verrouillées. Un dispositif de secours supplémentaire, la herse, lourde grille en métal ou en bois, pouvait être abaissée pour bloquer l’entrée. En outre, les portes étaient généralement dotées de petites guérites permettant de mieux voir, piéger et contre-attaquer tout force envahisseuse. Certains châteaux comportaient un espace clos appelé barbacane, situé devant la porte. Les assaillants souhaitant atteindre l’entrée devaient se hasarder dans cet espace où ils étaient susceptibles d’être pris en embuscade. Les entrées coudées, où le franchissement de la porte nécessitait de faire au moins un virage à 90 degrés, servaient à la même chose.
De solides murs de pierre et des pièges ingénieusement posés ne suffisaient pas à garantir complètement la sécurité d’un château. Par une conception astucieuse, le bâtiment lui-même devait devenir une machine de guerre. Les instruments de défense étaient concentrés sur le chemin de ronde, un passage surélevé et protégé situé derrière remparts. Ce passage reliait toutes les parties du château, était parfois couvert et était protégé par un parapet, un petit mur au-dessus de la muraille principale, doté d’ouverture à travers lesquelles on pouvait voir… et tirer des flèches, entre autres choses.
Depuis cette position privilégiée, les défenseurs pouvaient déchaîner une pluie mortelle de projectiles sur leurs assaillants. Ils jetaient des pierres, de l’eau ou du vin bouillants ou encore du sable chaud, qui s’infiltraient dans les fentes des armures des assaillants. Les projectiles incendiaires, comme les pots à feu remplis d’huile ou de goudron, pouvaient faire semer le chaos dans les lignes ennemies. Les créneaux, les meurtrières et les embrasures offraient des ouvertures protégées par lesquelles tirer des flèches. Avec le développement de l’artillerie aux 14e et 15e siècles, on se mit à tirer avec des canons depuis ces positions. Des meurtrières placées au-dessus des portes et découpées dans les plafonds des guérites permettaient aux défenseurs de lâcher des projectiles ou des liquides brûlants sur tout assaillant parvenu jusque-là.
En exploitant le potentiel de machine à tuer du château, un petit nombre de défenseurs pouvaient maintenir de larges contingents d’ennemis à distance. En conséquence, les assauts de grande ampleur étaient peu fréquents, bien qu’ils eussent pu survenir lorsque les assaillants disposaient de suffisamment de ressources, d’hommes et de machines de guerre. Un tel assaut eut lieu en 1147 quand une force expéditionnaire de croisés européens en route pour la deuxième croisade arriva aux portes de Lisbonne, ville alors aux mains des musulmans. Là, les croisés déployèrent des béliers, des mangonneaux (des armes de siège permettant de catapulter des projectiles) et des tours de siège mobiles pour lancer un assaut. Ils employèrent également la technique de la sape qui consistait à creuser des tunnels sous les murailles, dont l’ossature était souvent en bois, puis à y mettre le feu pour les faire s’effondrer. En l’espace de quatre mois, les croisés contraignirent la ville à la reddition.
Cependant, étant donnés le coût et la rareté des hommes et des ressources, les unités d’assaut rencontraient rarement le succès. Il était plus courant pour les armées médiévales de faire le blocus d’un château ou de l’encercler dans le but d’épuiser ses défenseurs jusqu’à ce qu’ils se rendent. Les sièges de ce type pouvaient durer plusieurs mois, ainsi que ce fut le cas à Algésiras, dans le sud de l’Espagne. L’opération militaire dont il est question débuta en 1342 et dura vingt-et-un mois lors desquels les forces chrétiennes d’Alphonse XI assiégèrent la ville tenue par les musulmans. Ce fut une opération complexe qui vit intervenir de nombreux corps et des machines de guerre innovantes des deux côtés.
Les défenseurs musulmans étaient armés de canons rudimentaires que les Espagnols appelaient truenos (qui signifie « coup de tonnerre ») en raison du bruit terrifiant qu’ils faisaient. Pour appuyer son assaut et percer les murs de la ville, Alphonse demanda la livraison d’engeños, un type de catapulte.
Chaque nuit, les habitants de la ville s’efforçaient de réparer les dégâts faits durant la journée. La quantité de projectiles lancées contre les murs d’Algésiras fut telle que près d’un siècle et demi plus tard, en 1487, durant la prise de Grenade (1481-1492), Ferdinand le Catholique dépêcha un détachement dans la ville pour récupérer toutes les boules de pierre que l’on pouvait encore y trouver afin de les réutiliser dans le bombardement de Malaga.
LA VIE À L’INTÉRIEUR
La communauté vivant à l’intérieur du château était parfois de taille assez importante, bien que les effectifs aient varié selon le lieu et l’époque. Par exemple, la forteresse templière de Safed, dans le nord d’Israël, qui fut reconstruite vers 1260, avait une capacité de 2 200 soldats en temps de guerre et une garnison permanente de 1 700 hommes s’y établissait en temps de paix. En revanche, au 15e siècle, de nombreux châteaux placés sous l’autorité militaire espagnole virent leur population décliner pour n’atteindre plus qu’un ou deux chevaliers et quelques serviteurs. Situés loin de la frontière avec al-Andalus, la partie de la péninsule ibérique sous contrôle musulman, ces châteaux n’étaient pas vraiment menacés et n’avaient par conséquent besoin que de peu de défenseurs. Dès avant cela, en 1271, le roi Jacques Ier d’Aragon avait autorisé le gouverneur de la forteresse stratégique de Biar, à Alicante, à la frontière avec la Castille, à y rester avec seulement douze hommes, une femme, une mule et trois chiens.
Que la communauté du château soit grande ou petite, ses membres avaient besoin d’espace pour vivre ; pour stocker de la nourriture, de l’eau et du bétail ; et pour entreprendre des activités artisanales et domestiques. Les plus anciennes forteresses, celles situées dans des zones frontalières instables ou ayant connu les vicissitudes de la guerre étaient généralement des environnements peu confortables en raison de leur orientation militaire.
D’autres châteaux offraient quant à eux toutes sortes de conforts à leurs occupants : latrines, citernes, puits, foyers, cuisines, fours et, bien sûr, chapelles. Comme ils servaient de centres de collectes des loyers féodaux, généralement payés en nature, certains complexes possédaient d’immenses réserves pour entreposer ces biens. Il n’était pas rare que les châteaux possèdent leurs propres boulangeries, distilleries et forges.
Certaines forteresses importantes comprenaient de vastes salles de réception, où rois, nobles et prélats pouvaient exhiber leur statut. Si le mobilier de ces pièces avait tendance à être austère, la décoration était raffinée. Les murs et les plafonds étaient souvent ornés de tableaux ou de tapisseries qui, en plus de leur valeur décorative, isolaient de l’humidité et des courants d’air.
DÉCLIN ET EFFONDREMENT
Pendant plus de 500 ans, les châteaux médiévaux assurèrent la défense de leurs occupants tout en étant des symboles de prestige. Mais au 16e siècle, le développement de l’artillerie moderne avait rendu bon nombre de châteaux médiévaux obsolètes. Les boulets de canon avaient la puissance nécessaire pour endommager les murailles des châteaux, rendant leur structure inadaptée et inefficace.
Avec le temps, l’architecture traditionnelle des châteaux avec de hautes murailles entourant un donjon en pierre haut perché sur une motte se vit lentement remplacer par un nouveau modèle de fortification bâtie pour résister au feu des canons. Ces nouvelles fortifications furent conçues pour résister aux tirs des canons avec des bastions et d’épais murs anguleux enfoncés dans le sol.
Quant aux châteaux existants, certains furent convertis en palais, des résidences légèrement fortifiées aux grandes fenêtres percées dans des murs autrefois impénétrables, avec des aménagements supplémentaires, et peut-être même des jardins. L’alcazar de Ségovie, par exemple, fut construit en tant que fort au 12e siècle et devint par la suite un palais pour les monarques castillans. Beaucoup d’anciens châteaux furent en revanche abandonnés. Plus récemment, certains ont été convertis en musées ou monuments ; le château de Caen abrite désormais le musée de Normandie, et le château de Scarborough, bien qu’en ruines, est une attraction touristique du Yorkshire du Nord. Ayant résisté à de nombreux combats violents, aux avancées technologiques et au poids des siècles, ces édifices croulants mais non moins majestueux sont des témoins silencieux (et des symboles) d’une ère où ils jouèrent un rôle central dans l’histoire de l’Europe.