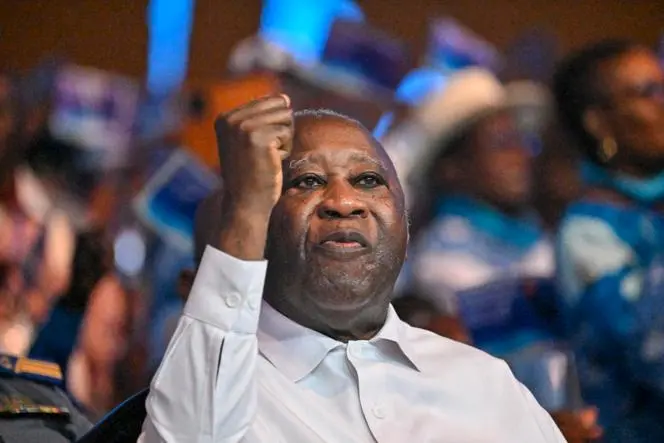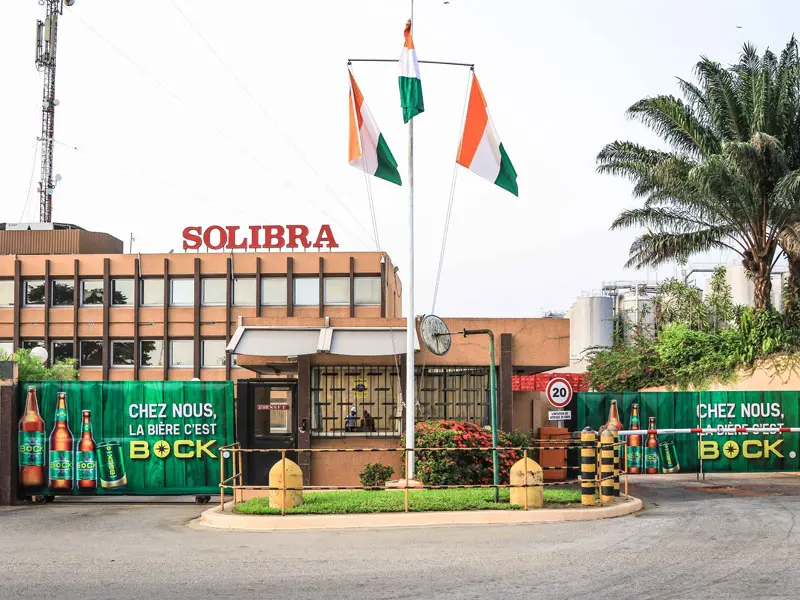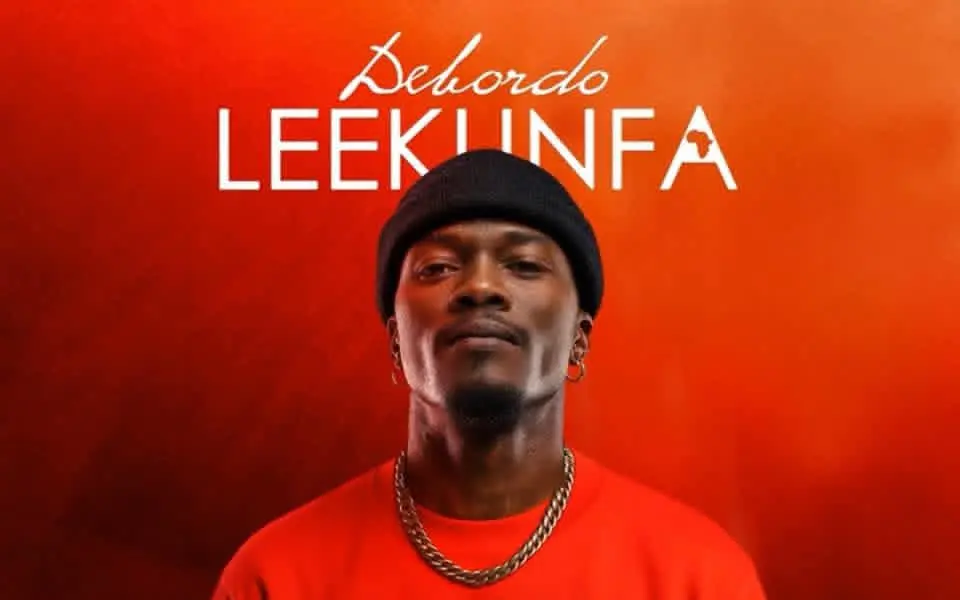Santé mentale : un tabou au masculin

Selon le dernier rapport de l’Observatoire national du suicide, le taux de suicide chez les hommes est trois fois plus élevé que chez les femmes : en 2022, il s’élevait à 20,8 décès pour 100 000 hommes, contre 6,3 pour 100 000 femmes. Même si les tentatives de suicide sont plus fréquentes chez les femmes, elles sont moins souvent mortelles que chez les hommes, en raison des méthodes utilisées.
Dans leur grande majorité, les hommes ne sont pas conscients de souffrir de troubles psychiques, les minimisent ou n’osent pas en parler, ni à leurs proches, ni à des professionnels de santé. Le silence des hommes sur leur santé mentale les expose à l’errance diagnostique et à une aggravation des pathologies psychiatriques.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit le trouble mental par « une altération majeure, sur le plan clinique, de l’état cognitif, de la régulation des émotions ou du comportement d’un individu. Il existe de nombreux types de troubles mentaux, désignés aussi sous le nom de problèmes de santé mentale : troubles anxieux, dépression, troubles bipolaires, troubles post-traumatiques, schizophrénie, troubles de l’alimentation, comportements perturbateurs dyssociaux, troubles neurodéveloppementaux… ». Toutefois, la santé mentale ne consiste pas seulement en une absence de troubles psychiques : elle correspond aussi à un état complet de bien-être psychologique, émotionnel et social.
D’après une enquête menée en 2022 par l’institut de sondage Consumer Science & Analytics, si neuf hommes sur dix estiment qu’il est normal d’exprimer ses émotions, un sur deux déclare encore rencontrer des difficultés à le faire. Toutefois, six hommes sur dix considèrent que le sujet du bien-être mental est plus facile à aborder aujourd’hui qu’il ne l’était pour les générations précédentes. L’héritage culturel et historique des modèles de virilité continue néanmoins de peser lourdement sur le rapport des hommes à leur santé mentale.
Des campagnes de sensibilisation à la santé physique et mentale des hommes, comme le mouvement Movember lancé en 2003, sont aujourd’hui essentielles pour pallier le manque d’information. Dans cette perspective, l’action publique a un rôle clé à jouer pour renforcer la lutte contre la stigmatisation des troubles mentaux, quels qu’ils soient et quel que soit le genre des personnes concernées.
LES HOMMES SOUFFRENT EN SILENCE
Boris Chaumette, enseignant-chercheur à l'Université Paris Cité et médecin psychiatre au GHU Paris, constate que « les femmes se tournent plus facilement vers les psychiatres ou les psychologues, ont moins de réticences à parler d’elles et de leurs symptômes, […] et trouvent plus facilement les mots pour exprimer leurs difficultés ». À l’inverse, « les hommes sont plus réticents à venir consulter », et lorsqu’ils le font, c’est souvent « parce qu’un membre de l’entourage les y a fortement incités, voire a exercé une forme de chantage ».
Selon Maud Le Rest, journaliste et autrice de l’essai intitulé Tu devrais aller voir quelqu’un, « les hommes sont dans une espèce de déni » face à leur santé mentale. Si elle a écrit sur ce sujet, c’est, dit-elle, « pour alerter [les hommes] sur leur propre bien-être à eux, et aussi [montrer] que c’est un peu leur faute quelque part ».
Le médecin observe que les hommes « parlent moins spontanément de leur souffrance, se livrent moins facilement sur leurs symptômes et dissimulent davantage leur mal-être au cours des consultations », souvent plus brèves que celles des femmes. « Même lorsqu’un homme accompagne un proche (par exemple, un enfant malade), il est plus difficile pour le psychiatre de recueillir les informations médicales. Il n’est pas rare qu’il appelle sa compagne en consultation pour pouvoir répondre aux questions posées ».
Le docteur Boris Chaumette rappelle que « les dépressions sont plus fréquentes chez les femmes ». Le ratio, estimé à 1,7, indique qu’en moyenne, pour dix hommes souffrant de dépression, on compte environ dix-sept femmes affectées. Le psychiatre explique « qu’aucune différence de définition des troubles psychiatriques n’a été établie entre les hommes et les femmes dans les classifications actuelles ». Pourtant, même si la définition médicale est la même, les hommes et les femmes ne manifestent pas toujours la dépression de la même façon.
« Là où les femmes se font plus volontiers du mal à elles-mêmes, les hommes expriment davantage leur mal-être par des comportements externalisés. Par exemple, ils peuvent prendre davantage de risques, ce qui peut correspondre à des équivalents suicidaires », explique le chercheur. Maud Le Rest constate que « les hommes vont beaucoup plus avoir des comportements violents, chercher à se battre, prendre de la drogue ou conduire [alcoolisés] ». Chez « les femmes, la violence sera plus intériorisée. Il y aura plus de tentatives de suicide, de scarification, et d'auto-dénigrement ».
« En outre, la dépression chez les hommes peut se manifester par des addictions », ajoute le docteur. « Régulièrement, les hommes se réfugient dans l’alcool, ce qui peut donner la fausse impression de contrôler les symptômes, en les masquant temporairement, [et retarder une prise en charge efficace]. En réalité, l’alcool aggrave la dépression à moyen terme, ce qui conduit à un cercle vicieux et à l’instauration d’une dépendance. […] L’alcool peut conduire à de la violence en agissant comme un désinhibiteur du comportement. Cela est d’autant plus à risque que la dépression chez les hommes se manifeste plus volontiers par de l’irritabilité et de l’agressivité ».
Pour Maud Le Rest, qui a mené une enquête sur la santé mentale masculine en s’appuyant sur de nombreux témoignages d’hommes, ces derniers « ne sont clairement pas assez conscients [de ces spécificités], parce qu’ils considèrent que c'est peut-être quelque part dans l'ordre biologique des choses qu'un homme soit plus violent ».
Boris Chaumette affirme « qu'il y a deux fois plus de tentatives de suicide chez les femmes, […] bien qu’on estime qu’environ trois-quarts des morts par suicide soient des hommes ». Pour le chercheur, « plusieurs raisons expliquent pourquoi le sexe masculin augmente le risque de suicide. D’abord les moyens utilisés sont plus léthaux chez les hommes que chez les femmes. En outre, les hommes ne sont pas assez accompagnés : ils sont davantage réticents à consulter, le retard d’accès aux soins est plus important et lorsqu’ils consultent, les symptômes sont devenus plus sévères et donc plus difficiles à traiter ».
SE TAIRE POUR « NE PAS PERDRE DE POINTS DE MASCULINITÉ »
Cette réticence à demander de l’aide s’explique en partie par « des freins culturels et de nombreux stéréotypes : “un homme, ça ne pleure pas”, “si je consulte, c’est que je suis faible”, etc. À force d’être répétés dans la société, ces stéréotypes sont intégrés par les hommes eux-mêmes ». Le psychiatre rappelle que ces messages sont fondés sur « le mythe de la virilité [qui] imposerait de refouler ses émotions et ses sentiments ».
Pour Maud Le Rest, si les hommes ne parlent pas de leur souffrance mentale, c’est « d’une part, parce qu’ils ont beaucoup de mal à accéder à leurs émotions. […] Une autre chose, c’est qu’il y a plein de préjugés sexistes qui [associent] la psychologie aux femmes, [insinuent] que les problèmes de santé mentale sont censés concerner surtout les femmes, que se confier est un truc de femmes, parce que les hommes sont persuadés d’avoir des choses plus importantes à gérer ». Elle rappelle qu’en 2022, sur Doctolib, 78 % des consultations chez le psychologue concernaient des patientes. L’autrice remarque « qu’il y a beaucoup [d’hommes] aussi qui vont sortir ce genre d'arguments : “je n’ai pas le temps, […] “ça ne sert à rien d’en parler”, […] ou “je suis trop intelligent pour ça” ».
De plus, le docteur Boris Chaumette souligne que « dans les groupes masculins, la psychiatrie et le recours à des soins sont encore trop souvent utilisés pour se moquer ou blâmer : “t’es dingue, tu vas finir à l’HP” ». Cette pression sociale qui s’exerce entre hommes les conduit à se murer dans le déni et le silence. Le psychiatre estime que « la stigmatisation vis-à-vis des troubles psychiques constitue un frein puissant à l’accès aux soins », aussi bien pour les hommes que pour les femmes, ces dernières étant encore largement sous-écoutées et sous-diagnostiquées dans le milieu médical.
Au fil des témoignages, Maud Le Rest a constaté avec surprise « que les amitiés masculines n’étaient pas du tout propices à la parole et à la confession », plongeant certains hommes dans une forme de solitude et de mutisme. « La plupart des hommes [qui vont mal], n’ont personne à qui se confier » autour d’eux. « Ce qu’ils me disaient la plupart du temps, c’est “qu’en groupe d’amis masculins, [on se retrouvait] plutôt pour faire des activités, pour se détendre, mais qu’on n’allait pas parler de choses trop profondes ou trop sensibles, puisqu’on ne voulait pas être jugés par ses pairs. On ne voulait pas perdre des points de masculinité, on va dire”. […] Pas mal [d’hommes] m’ont dit : “moi, si je veux des conversations profondes, c’est plus avec des femmes” », explique la journaliste.
« Pourquoi ils ont du mal à identifier leur mal-être, leurs symptômes ? », interroge-t-elle. « C’est parce que, vu qu’ils n’en parlent pas entre eux, ils ne sont pas entraînés non plus à parler de ce qu'ils ressentent. […] Certains ne sont tellement pas habitués à parler de leurs problèmes en règle générale qu’ils ne sont pas du tout [enclins] à aller voir quelqu’un et disent : “je ne vais pas parler de mes problèmes à un inconnu” ».
DÉSTIGMATISER LES TROUBLES MENTAUX
Boris Chaumette constate qu'« au cours des dernières années, une véritable évolution dans le regard que la société porte aux troubles psychiques. Bien que restant encore trop stigmatisées, ces maladies deviennent de moins en moins honteuses. […] Au vu de la fréquence de ces troubles, nous connaissons tous un proche qui a souffert d’un problème de santé mentale. Cette connaissance “par contact” lève progressivement le tabou », explique le docteur. D’après les données de l’OMS, la maladie mentale et les troubles psychiques touchaient en 2023 près d’un cinquième de la population, soit treize millions de Français.
Pour Maud Le Rest, le silence des hommes autour de leur santé mentale « n’est pas un problème de génération, c’est un problème de genre ». Elle tempère ainsi l’idée selon laquelle les jeunes hommes seraient naturellement plus progressistes : « je trouve que c’est un peu cliché de se dire que les jeunes sont plus ouverts ». Cette perception, selon elle, reflète surtout une vision centrée sur les grandes villes. « La plupart des gens, un peu partout en France, des hommes en tout cas, je ne pense pas qu'ils aient spécialement évolué là-dessus », souligne-t-elle.
« Certaines personnalités n’hésitent plus à faire leurs “coming out psychiatriques” », comme Tom Holland ou Robbie Williams, relève le psychiatre, qui estime « que ces témoignages de personnalités publiques, […] venus d’hommes auxquels on peut s’identifier, contribuent à déconstruire les mythes de l’homme viril qui ne doit pas exprimer ses émotions ». Pour Maud Le Rest, se focaliser sur un témoignage individuel, comme celui de Nicolas Demorand évoquant sa bipolarité, revient cependant à occulter des enjeux systémiques bien plus larges : « on ne parle ni de la crise de la psychiatrie en France, ni de la crise des hôpitaux, ni du coût prohibitif des soins ».
Le docteur Boris Chaumette espère « que la mise en lumière de cette thématique comme Grande Cause nationale 2025 en France permettra de faire évoluer les mentalités et de lutter contre le manque d’informations ». Pour lui, « il semble important de combiner actions d'envergure et actions plus ciblées vis-à-vis de groupes difficiles à toucher », qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes.