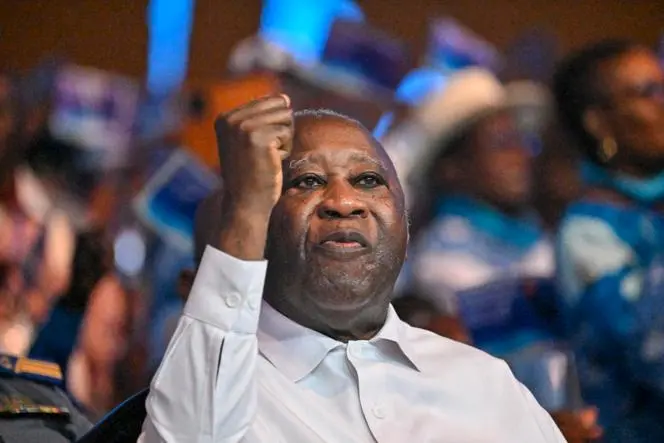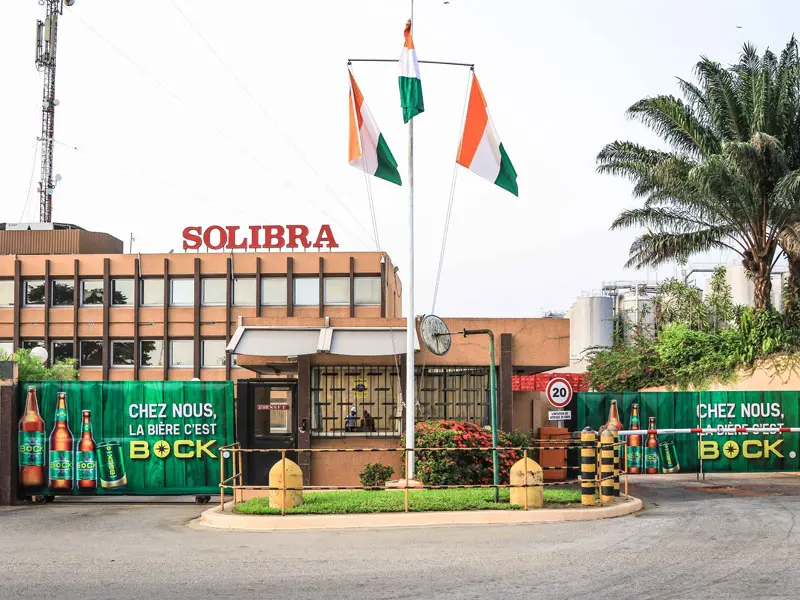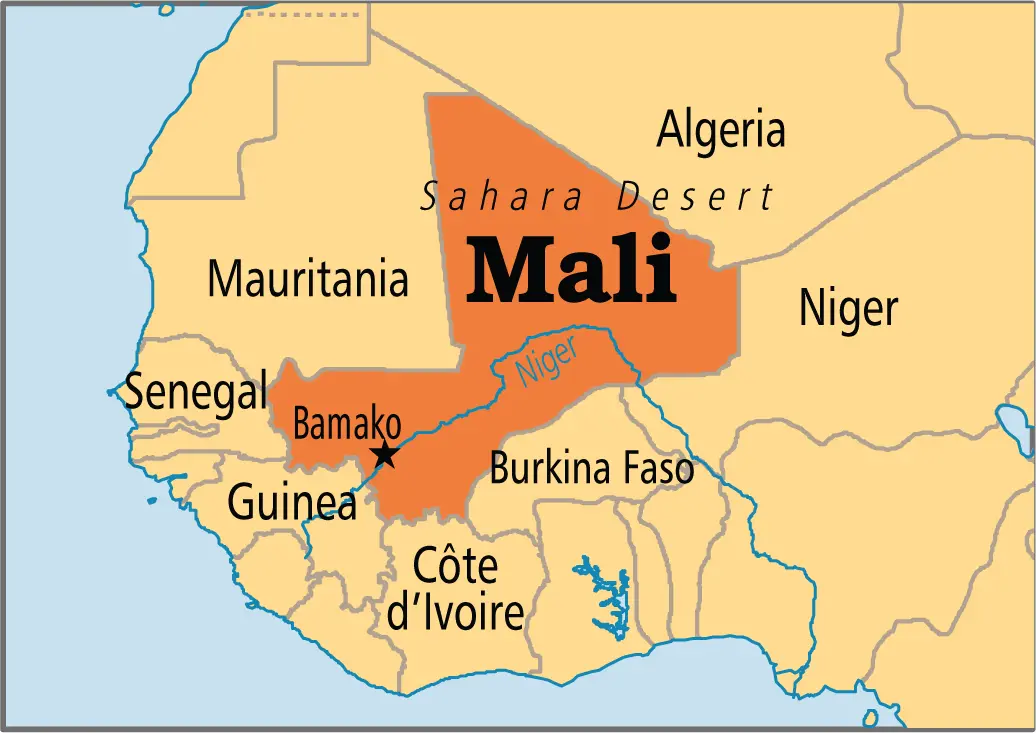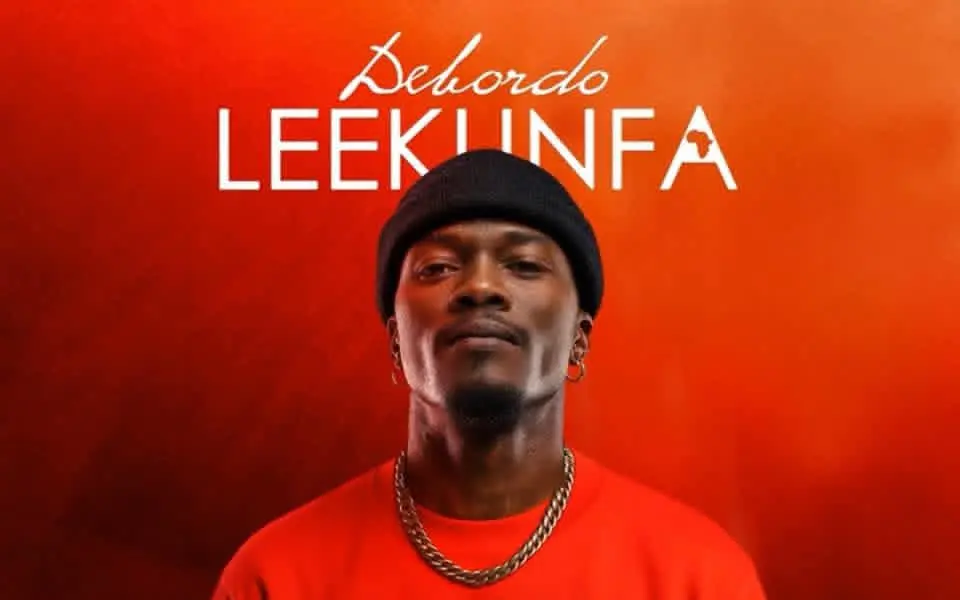Vlad l’Empaleur : derrière le prince sanguinaire, l’ombre de Dracula

Dracula, prince des ténèbres, seigneur des morts-vivants ! Ce personnage mythique a vu le jour en 1897, fruit de l’imagination débordante de l’écrivain irlandais Bram Stoker. Mais il partage également son nom avec une personnalité bien réelle dont la réputation était toute aussi effrayante. Vlad III Draculea était un voïvode, un dirigeant militaire que l’on peut comparer à un prince, qui a régné par intermittence sur la Valachie entre 1448 et 1476. En 1859, cette principauté a rejoint la Moldavie pour former la Roumanie. On connaît ce voïvode sous plusieurs noms : Vlad III, Vlad Dracula (le fils du dragon), mais le plus connu est Vlad l’Empaleur (Vlad Țepeș en roumain). C’était un dirigeant brutal et sadique qui avait la réputation de torturer ses ennemis. Selon certaines estimations, il serait responsable de la mort de plus de 80 000 personnes. Un grand nombre d’entre elles furent empalées.
La cruauté de Vlad III était bien réelle, mais sa vile réputation se répandit dans l’Europe du 15e siècle avec l’avènement de la presse écrite qui coïncidait avec son règne. Les pamphlets propagandistes rédigés par ses ennemis étaient très populaires. Des siècles plus tard, la sinistre réputation de Vlad l’Empaleur prit un nouveau tournant alors que Bram Stoker tombait sur le nom de Dracula au détour d’un livre d’histoire. Il apprit qu’il pouvait également signifier « démon » en Valachie et décida de nommer ainsi son vampire fictif. Et cependant, Vlad III est aujourd’hui une sorte de héros national en Roumanie, où l’on se souvient de lui comme le défenseur de son peuple contre les invasions ennemies, menées par des soldats turcs ou des marchands germaniques.
UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Vlad III, né vers 1431 en Transylvanie, région escarpée et verdoyante appartenant officiellement à la Roumanie depuis 1947, était le deuxième d’une fratrie de quatre frères. Sa mère était la princesse Cnejna de Moldavie. Son père, Vlad II, le fils illégitime d’un membre de la noblesse walachienne, passa sa jeunesse à la cour de Sigismund de Luxembourg, roi de Hongrie et futur empereur du Saint-Empire romain germanique.
Vlad II fut admis au sein de l’Ordre du Dragon l’année où Vlad III vit le jour. À l’instar d’autres ordres de chevalerie, cette société militaire chrétienne, fondée en 1408 par Sigismund, était largement inspirée des Croisés du Moyen-âge. Ses membres étaient au nombre de vingt-quatre et étaient chargés de combattre l’hérésie et d’enliser l’expansion ottomane. En rejoignant l’ordre, Vlad II gagna le surnom de Dracul, « dragon ». Son fils, Vlad III, fut ainsi appelé Draculea, ou Dracula, « le fils du dragon ». En 1436, Sigismund nomma Vlad II voïvode de Valachie, mais ce dernier le trahit. Il changea rapidement d’allégeance et s’allia avec le Sultan Murad II, dirigeant ottoman. Pour s’assurer de sa loyauté, le sultan demanda à Vlad II de lui céder deux de ses fils : Vlad III et Radu l’Élégant.
En 1447, Vlad II fut renversé par des boyards walachiens, des aristocrates, qui mirent fin à son règne sur la Valachie. S’ensuivit sa capture, puis sa mort. La même année, le frère aîné de Vlad III, Mircea II, fut rendu aveugle et enterré vivant. Jean Huniad, régent de Hongrie à l’origine de l’assassinat de Vlad II, désigna Vladislav II, un noble walachien, comme successeur au titre de voïvode de Valachie. Les historiens ignorent si cet enchaînement d’événements a motivé la soif de vengeance de Vlad III, mais une chose est sûre : après la fin de sa détention dans les prisons ottomanes, autour de 1447, sa lutte pour accéder au pouvoir commença.
En 1448, avec l’aide des Ottomans, Vlad III expulsa Vladislav II de Valachie et accéda au trône. Il était alors âgé de seize ans. Son règne de voïvode ne dura que deux mois, le temps qu’il fallût aux Hongrois pour réinstaurer Vladislav sur le trône. Vlad III fut exilé et l’on ignore beaucoup sur les huit années qui suivirent, alors qu’il arpentait l’Empire ottoman et la Moldavie.
Au cours de son exil, Vlad III changea de camp dans le conflit qui opposait les Ottomans et les Hongrois, gagnant le soutien militaire de la Hongrie. Vladislav II fit de même et rejoignit les Turcs, une décision qui attisa le conflit entre les deux prétendants au trône de Valachie. Vlad III affronta Vladislav II devant les murs de Târgoviște le 22 juillet 1456 et le décapita au cours d’un combat singulier. Ainsi débuta le règne de Vlad III.
UN RÈGNE DE TERREUR
La Valachie avait été ravagée par la guerre sans fin entre les Ottomans et les Hongrois et par les conflits intestinaux entre boyards belliqueux. Le règne de Vlad III commença par une stricte répression du crime, employant une politique de tolérance zéro envers les offenses même les plus mineures, comme le mensonge. Il nomma des gens du commun et même des étrangers, à des postes d’importance publique ; une stratégie pour consolider son règne en créant des représentants complètement dépendants de lui. Son titre de voïvode lui octroyait le droit d’élire, de déposer et même d’exécuter ses nouveaux fonctionnaires selon son bon vouloir.
Vlad III réservait aux boyards, ces membres de la noblesse qui avaient fait tuer son père et son frère aîné, un sort particulier. En 1459, il invita 200 d’entre eux et leur famille à un grand banquet pour célébrer Pâques. Là, il fit poignarder et empaler les anciens et les femmes. Des hommes, il fit des esclaves. Beaucoup de ces travailleurs moururent d’épuisement lors de la construction de la forteresse de Poenari, une des résidences favorites de Vlad III.
Pour remplacer les boyards, Vlad III créa de nouvelles élites : les viteji, une division militaire de fermiers qui s’étaient distingués sur le champ de bataille, et les sluji, une sorte de garde nationale. Il libéra également les paysans et les artisans de Valachie, leur épargnant les tributs qu’ils devaient payer à l’Empire ottoman.
Les mesures domestiques de Vlad III n’étaient cependant pas bienveillantes. La justice brutale qu’il réservait à ses ennemis était parfois appliquée à son propre peuple. Pour se débarrasser des sans-abris et des mendiants, qu’il considérait être des voleurs, il en invita un grand nombre à un festin et les enferma avant de les brûler vifs. Le fils du dragon extermina les Roms ou les enrôla de force dans son armée. Il imposa une lourde taxe à la population germanique et bloqua leurs voies commerciales quand ils refusèrent de payer.
De nombreux Germaniques qui souffrirent du joug de Vlad Dracula étaient Saxons - à ne pas confondre avec les Anglosaxons d’Angleterre. Il s’agissait de migrants germaniques qui s’étaient installés en Transylvanie au 12e siècle après la conquête de la région par la Hongrie. Marchands fortunés pour la plupart, Vlad III les voyait comme les alliés de ses ennemis.
Au cours des années qui suivirent, le voïvode rasa des villages entiers de Saxons et empala des milliers de personnes. En 1459, quand la cité saxonne de Transylvanie, Kronstadt (l’actuelle Brașov), déclara son soutien à un rival du voïvode, sa réponse fut d’une brutalité sans nom. Après avoir placé un embargo économique sur les produits saxons en Valachie, il empala 30 000 personnes. On dit même qu’il dîna parmi elles afin de pouvoir admirer personnellement leur souffrance. Kornstadt fut réduite en cendres. En Valachie, les marchands saxons qui bravaient ses lois commerciales étaient empalés.
Bien que Vlad continuât à s’identifier avec le prestigieux Ordre du Dragon, signant de son nom Wladislaus Dragwlya, « le fils du dragon », ses ennemis de l’époque l’affublèrent du sobriquet bien moins noble de Tepes, « l’Empaleur ».
L’Empaleur organisa également des attaques sanglantes dirigées contre les communautés catholiques. Il fut soutenu par une grande partie de son peuple qui, en tant que Chrétiens orthodoxes, se sentaient discriminés par les Hongrois et les Saxons catholiques de Transylvanie. Des villes, telles que Sibiu, Tara Barsei, Amlas et Fagara en firent les frais et subirent des pertes énormes avant de se rendre en 1460. Ces représailles attirèrent l’attention du pape Pie II qui publia un rapport en 1462, déclarant que Vlad III avait tué plus de 40 000 personnes.
DES MESURES DRASTIQUES
La politique étrangère que mit en place Vlad III différait de celle de son père et de beaucoup d’autres dirigeants de son temps. Il ne cessa jamais de s’opposer aux Turcs, en cela il avait le soutien de Matthias Corvin, Matthias 1er, le fils de Jean Huniad et roi de Hongrie.
Les tactiques de Vlad Dracula, sur le champ de bataille et en dehors, à l’encontre des Turcs étaient d’une extraordinaire brutalité. En 1459, le sultan Mehmed II envoya des émissaires à l’Empaleur, réclamant un tribut de 10 000 ducats et 300 jeunes garçons. Lorsque les diplomates refusèrent de retirer leur turban, prétextant une coutume religieuse, Vlad III salua leur piété… en clouant leur couvre-chef sur leur tête. En 1461, les Turcs proposèrent de rencontrer le voïvode afin de négocier une trêve. Ils avaient, en réalité, l’intention de lui tendre une embuscade. La réponse de Vlad III fut de mener une incursion dans les territoires turcs au sud du Danube.
Au printemps 1462, Mehmed II avança sur la Valachie à la tête d’une armée de 90 000 hommes. Après avoir mené une série de raids nocturnes et s’être livré à des actions de guérilla, Vlad III revint à ses habitudes et empala plus de 23 000 prisonniers et leur famille, les exposant sur la route de ses ennemis, devant les murs de Târgoviște. « Des nourrissons encore dans les bras de leur mère se trouvaient sur les pieux, écrivait Matei Cazacu, historien français, et des oiseaux avaient établi leur nid dans leurs entrailles. » La vision d'horreur était telle que Mehmed II, après avoir posé les yeux sur cette « forêt » de morts, fit volte-face et s’en retourna à Constantinople.
Vlad III écrivit à Matthias Ier, expliquant qu’il avait « tué paysans, hommes et femmes, vieux et jeunes […]. Nous avons massacré 23 884 Turcs, sans compter ceux que nous avons fait brûler dans leur maison, ou les Turcs décapités par nos soldats ». Pour prouver la véracité de ses paroles, il joignit à sa lettre des sacs pleins de nez et d’oreilles ôtés à ses victimes. Comme le reconnut lui-même Vlad III, la plupart des victimes n’étaient que de simples paysans, des Serbes chrétiens et des Bulgares qui avaient été soumis au joug des Turcs.
En fin de compte, les Turcs sortirent victorieux de ce conflit grâce aux boyards walachiens qui s’étaient ralliés à Radu l’Élégant, le frère de Vlad l’Empaleur. Radu avait promis à l’aristocratie qu’en se rangeant aux côtés des Ottomans, ils récupèreraient les privilèges dont les avait privés Vlad III. Radu s’était attiré les bonnes grâces de la population rom, fatiguée de la soif de sang de l’Empaleur.
Le pouvoir, l’argent et les troupes de Vlad III étaient si dispersés que Matthias Ier parvint à le faire prisonnier en 1462. Vlad fut emprisonné en Hongrie durant douze ans. Au cours de ces années, le pouvoir changea plusieurs fois de mains en Valachie. Vers 1475, Matthias Ier envoya Vlad Dracula reprendre la Valachie au nom de la Hongrie. En novembre 1476, il ressortit initialement victorieux de ce conflit, mais souffrit un mois plus tard d’une terrible défaite. Son rival, soutenu par les troupes ottomanes, lui tendit une embuscade et le tua avant de le décapiter. À en croire les écrits, sa tête fut envoyée au sultan Mehmed II, à Constantinople, pour être exposée au-dessus des portes de la cité.
Malgré cela, Vlad III n’aurait pu qu’être une simple note de bas de page dans l’histoire du Moyen-âge, sans un ouvrage publié en 1820. Écrit par William Wilkinson, consul britannique en Valachie, An Account of the Principalities of Wallachia and Moldavia: With Various Political Observations Relating to Them (Un compte-rendu des principautés de Valachie et de Moldavie et observations politiques variées s’y rapportant) se plonge dans l’histoire de la région et mentionne le tristement célèbre seigneur de guerre, Vlad l’Empaleur.
Bram Stoker ne s’est jamais rendu dans la patrie de Vlad Dracula, mais on sait qu’il est tombé sur l’ouvrage de Wilkinson en 1890. Après l’avoir lu, il a écrit : « Voïvode (Dracula) : dans la langue walachienne, “dracula” signifie DÉMON. Les Walachiens avaient pour l’habitude de surnommer ainsi chaque personne qui se distinguait par son courage, ses actions cruelles ou sa ruse. » La vie de Vlad l’Empaleur avait pris fin depuis longtemps mais la légende tenace de Dracula ne faisait que commencer.
UNE RÉPUTATION MONSTRUEUSE
Vlad Dracula était-il la seule source d’inspiration pour le roman à succès qu’allait devenir le Dracula de Bram Stoker ?
L’écrivain irlandais a publié en 1897 un roman qui se déroule en Transylvanie et dont l'antagoniste est un vampire hypnotique. Dracula a réjoui ses lecteurs qui ont commencé à chercher d’où l’auteur avait tiré son inspiration. Beaucoup ont émis l’hypothèse que la vie sanglante de Vlad l’Empaleur, ce souverain walachien du Moyen-âge que l’on connaissait également sous le nom de Dracula, avait seulement servi de base au personnage de Stoker. Mais l’écrivain s’est inspiré de plusieurs sources pour la plus connue de ses histoires.
Les vampires étaient à la mode à la fin de la période victorienne, et Stoker était sûrement familier des premières œuvres gothiques, telles que La Fiancée de Corinthe, poème de Goethe écrit en 1797, Le Vampyre, une nouvelle de John Polidori rédigée en 1819 et le roman Carmilla de 1872 écrit par Joseph Sheridan Le Fanu. Les connexions remarquables entre Dracula et Le Capitaine Vampire, écrit dix-huit ans auparavant, en 1879, par Marie Nizet, poétesse belge de dix-neuf ans aux origines roumaines, ont également été soulignées.
Bram Stoker avait certainement lu des histoires sur le vampirisme dans les Carpates et il écrivit en 1890 une nouvelle appelée The Un-Dead (Le mort-vivant) dont l'un des personnages principaux s'appelle Comte Wampyr. La même année, en vacances à Whitby, en Angleterre, Stoker est tombé sur un livre rare dans une librairie locale : An Account of the Principalities of Wallachia and Moldavia, écrit en 1820 par le diplomate britannique William Wilkinson. Il mentionnait le voïvode Dracula, expliquant dans une note de bas de page que dans la langue walachienne, dracula signifiait « démon » tandis qu’en hongrois, cela voulait dire « dragon ».
Stoker ne perdit pas de temps à transformer son Comte Wampyr en Dracula. Au cours du roman, lorsque son personnage principal dépeint un panorama historique à son invité, Jonathan Harker, le compte-rendu de Wilkinson se cache sans aucun doute derrière ces paroles. Au vu de toutes ces connexions, il semble très probable que la vie de Vlad III ait servi d’inspiration à Bram Stoker.
Plus récemment, certains experts et historiens ont cependant avancé une théorie alternative intrigante quant à la source primaire d’inspiration pour Dracula : une épidémie de choléra survenue au 19e siècle qui a causé la mort de plus de 1 000 personnes dans la ville de Sligo, dans la partie ouest de l’Irlande. La mère de Stoker, Charlotte Thornley, alors âgée de quatorze ans, en était une rescapée et l’a plus tard décrite à son fils sans lui épargner les détails.
En 2018, des chercheurs irlandais, menés par Marion McGarry, de la Sligo Stoker Society, ont étudié les écrits de Thornley. « Adulte, Bram a demandé à sa mère de lui écrire les souvenirs qu'elle gardait de l’épidémie, écrit Marion McGarry, et il a complété [ce qu’elle lui a confié] avec ses propres recherches. »
Cette épidémie de choléra avait créé un véritable chaos. Pour empêcher les personnes de fuir Sligo et de répandre la maladie, les autorités avaient fait creuser des tranchées autour de la ville et bloqué les routes. Les cadavres jonchaient les rues. Médecins et infirmiers plaçaient prématurément dans des fosses communes les patients atteints du choléra, rendus amorphes par l’opium ou le laudanum.
Bram Stoker était fasciné par la description que sa mère faisait des victimes du choléra enterrées vivantes. Un lien possible à l’état de mort-vivant de Dracula. Au cours d’un rare entretien à propos de son livre, Stoker, pourtant de nature très secrète, a reconnu que son histoire était « inspirée par l’idée d’une personne enterrée avant qu’elle ne soit vraiment morte ».
Le roman d’épouvante de Stoker a enflammé les imaginations et, des décennies plus tard, la représentation iconique de Dracula par Bela Lugosi sur grand écran en 1931 a fait rimer Dracula avec vampire pour le monde entier. L’accent de l’acteur hongrois et son sombre accoutrement ont donné vie au comte transylvanien avant d’inspirer d’innombrables imitations.
Les lieux en lien avec la légende de Dracula sont aujourd'hui des destinations touristiques populaires. Certains, comme la forteresse de Poenari, en Roumanie, un refuge d’importance pour le voïvode, sont associés à Vlad III. D’autres, comme le château de Bran, que l’on appelle couramment le château de Dracula, en Roumanie, n’ont rien à voir avec lui. Certains avancent que le château de Bran a servi d’inspiration à Stoker pour la demeure de Dracula dans le roman ; mais Stoker ne s’étant jamais rendu en Roumanie, il n’aurait jamais pu le voir en personne.